
Guadeloupe. Politique : Ka nou ka fé… épi yo ? (1)
Partagez sur
Partagez sur
Pointe-à-Pitre. Lundi 23 Juin 2025 – CCN – Alors que le 19e congrès des élus de Guadeloupe s’est tenu dans une ambiance particulière et avec l’absence remarquée de plusieurs figures politiques, les interrogations sur l’avenir institutionnel du pays restent entières. Derrière les discours de façade, une réalité s’impose : absence de vision partagée, manque d’audace, défiance citoyenne, faiblesse du mouvement nationaliste. Pour tenter de mieux comprendre la situation politique actuelle CCN s’est alors adressé à des universitaires* Julien Mérion et Fred Deshayes qui sont aussi des experts ayant accompagné Guy Losbar dans sa démarche. Dans cet entretien sans concession aucune Julien Mérion, politologue et observateur avisé de la vie politique guadeloupéenne revient sur les limites structurelles d’un système colonial à bout de souffle. Il évoque aussi les blocages internes, les compromissions électoralistes, les postures de la classe politique, la faiblesse actuelle du Mouvement Nationaliste Gwadloupéyen. Entre réalité et exigence, il nous invite avec une grande lucidité à une re-lecture en profondeur de la situation politique du pays — condition sine qua non pour trouver la voie de sortie à ces 4 siècles de colonisation.

Julien mérion
CCN – Pensez-vous que la classe politique guadeloupéenne – y compris les autonomistes et les indépendantistes – soit aujourd’hui prête, en termes de propositions concrètes en direction du peuple dans des domaines clés comme l’économie, la culture, l’éducation, la santé ou encore la jeunesse, à assumer ou assurer une autonomie réelle, voire une indépendance ?
1.La diversité des positions politiques guadeloupéennes face à l’autonomie
Julien Mérion : En quoi les compétences que vous présentez sont plus essentielles que l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement ou la coopération régionale ?
Quand on regarde le paysage politique guadeloupéen, il n’est en rien uniforme.
Les amalgames troublent souvent l’analyse objective. Certains élus sont ouvertement et franchement autonomistes et ne s’en cachent pas. D’autres sont plus réservés.
Si on s’en tient à une enquête que nous avons menée avec le CAGI auprès des Maires en 2024, sur les 30 maires interrogés 27 étaient favorables à une autonomie, avec des positions variables quant au degré de cette autonomie.
Par ailleurs, je ne pense pas que les élus soient hors sols. Si aujourd’hui une très grande majorité de Guadeloupéens, à la lueur du dernier sondage Qualistat, se prononce favorablement pour une évolution statutaire, je ne vois pas de raison pour qu’il en soit différemment pour les élus.
Le tout est une question d’engagement et de vision. Ce n’est peut-être pas au centre de leurs préoccupations.
CCN – À votre avis, quelles sont les raisons principales du désengagement électoral de plus en plus marqué en Guadeloupe ?
2.Les électeurs désertent : la faute à un vide de leadership
Julien Mérion : Le problème n’est pas que Guadeloupéen. Il est observable un peu partout dans le monde.
Dans tous les systèmes représentatifs, le peuple se désintéresse des urnes, en dehors d’enjeux importants. En Guadeloupe, il y a une déception générale sur la gestion des secteurs prioritaires comme l’eau et une méfiance réelle par rapport aux hommes politiques qui ne répondent pas aux attentes de leurs électeurs.
La Guadeloupe vit une crise de leadership depuis quelques années. Il ne peut y avoir de confiance politique sans adhésion à un projet et sans incarnation de ce projet par un groupe et des personnes emblématiques.
CCN – Comment interprétez-vous la défiance croissante des citoyens envers les responsables politiques ?
3.La fin du mythe de l’élu tout-puissant face à une société plus informée
Julien Mérion : Les changements de majorité n’ont pas apporté de changements significatifs dans les services publics et dans la vie des gens. Il y a donc une déception profonde. Par ailleurs, il y quelques décennies, l’élu détenait les clés de la connaissance des faits et des évolutions administratives et politiques.
Ce n‘est plus le cas. Le citoyen peut s’informer directement par les médias et les réseaux sociaux. Il est bien des fois en avance sur l’élu en matière d’information.
La fonction politique est dans ces conditions désacralisée.
En outre, le spectacle des affrontements, des changements de casquette politique et des petits et gros scandales décrédibilisent fortement l’élu. Mais il faut tenir compte de la capacité ambivalente de l’électeur. Malgré les critiques et le désappointement, il a tendance à reconduire les mêmes aux affaires. C’est un réflexe sécuritaire que l’on retrouve dans d’autres domaines et qui renvoie souvent au clientélisme.
CCN – Plusieurs maires de mouvements indépendantistes ont été élus. Selon vous, ont-ils réellement contribué à faire avancer cette cause ?
4.S’en remettre à la mobilisation pour conquérir des espaces de souveraineté”
Julien Mérion : Le problème se pose dans les mêmes termes en Martinique, en Kanaky, en Polynésie et d’une manière générale dans toutes les possessions ultramarines de la France.
Il faut certainement s’interroger sur l’usage politique des postes électifs. Il faut en connaître les limites et s’en remettre à la mobilisation pour conquérir des espaces de souveraineté.
La vraie question est donc celle de la mobilisation politique.
L’autre problème plus fondamental est celui de la culture du pouvoir qui doit accompagner toute démarche politique. Elle se construit dans les luttes politiques, électorales, sociétales.
Cette culture du pouvoir fait largement défaut depuis les premiers temps du mouvement indépendantiste et d’une manière plus générale à la Guadeloupe.
CCN – D’après vous, qu’est-ce qui a freiné ou empêché les élus de faire bouger les lignes de manière significative ces dernières années ?
5.S’affranchir de la dépendance mortifère vis-à-vis de l’Etat
Julien Mérion : Il y a en tout premier lieu le manque d’audace. Le pouvoir ne se donne pas. Il se prend tous les jours.
A quelque niveau que ce soit, la classe politique n’a pas su afficher un volontarisme conquérant.
Beaucoup d’élus n’ont pas saisi les mutations de la sociétés guadeloupéennes et l’impact de la mondialisation. Ils sont restés enfermés dans des recettes traditionnelles sans innovation.
Il faut aujourd’hui innover, inventer, imaginer afin de prendre en compte les nouveaux enjeux que sont la démocratie participative, l’écologie, le changement climatique, la souveraineté alimentaire. Il ne s’agit pas de faire un coup, de temps en temps, mais bien d’imprimer une nouvelle orientation à l’action publique.
Enfin je crois que les élus sont trop souvent englués dans une dépendance mortifère vis-à-vis de l’État. Il faut s’en affranchir. Pour cela il faut une vision à moyen terme et un projet politique partagé avec la population.
CCN – Nous en sommes au 19ème congrès des élus, et pourtant l’évolution institutionnelle semble toujours en suspens. Quelles en sont, selon vous, les causes?
6.L’évolution institutionnelle ne suffit pas : la Guadeloupe doit se penser en Nation
Julien Mérion : Je refuse de parler d’évolution institutionnelle qui n’est pas une marque de transformation significative. Il faut rompre avec l’identité législative, l’assimilation et l’assistanat politique.
Il faut placer la Guadeloupe en perspective dans le monde et dans la Caraïbe pour les générations futures.
La question de l’évolution statutaire est conditionnée en tout premier lieu par le consensus politique. Pour l’heure, il n’existe pas en Guadeloupe.
Ce consensus est miné par des jeux de pouvoir, des intérêts électoralistes et des querelles d’égo.La Guadeloupe ne se vit pas comme une Nation.
CCN – Comment analysez-vous l’affaiblissement du mouvement nationaliste en Guadeloupe aujourd’hui ?
7.La sempiternelle question de l’unité
Julien Mérion : Il est à l’image de la société guadeloupéenne.
Il y a eu très certainement dès le départ ce que j’appelle des tares congénitales et tous les mimétismes.
Un mouvement nationaliste sans culture du pouvoir reste cantonné à la contestation sans alternative crédible.
Il y a d’autre part la sempiternelle question de l’unité.
Trop souvent le mouvement nationaliste s’est édifié dans le tourbillon de l’exclusion. On en paie tôt ou tard le prix.
Il y a surtout la capacité de l’État d’en faire un épouvantail. Dès les années 60 on a opposé au combat pour la liberté et la dignité le ventre. « Lotonomi sé zasyèt vid » Cette offensive a poussé toutes les velléités de changement sur des postures défensives sans capacité de transcendance de l’emprise alimentariste.
Enfin le nationalisme des années 80 à aujourd’hui n’est pas celui des années 60. Il fallait réinventer la libération nationale à partir du réel guadeloupéen. Cela n’a, hélas, pas été fait. Pour autant, personne ne peut nier l’apport significatif en matière de mobilisation sociale avec les créations de l’UTA en 1970, pas plus qu’on ne peut nier les conquêtes identitaires et le sentiment d’appartenance national qui sont naturels aujourd’hui.
Les titres des articles parfois provocateurs sont de la rédaction de CCN’ c’est son ADN
NB : Pierre-Yves Chicot qu’on entend régulièrement sur tous les médias mainstream n’a pas souhaité répondre à la demande d’interview de CCN.
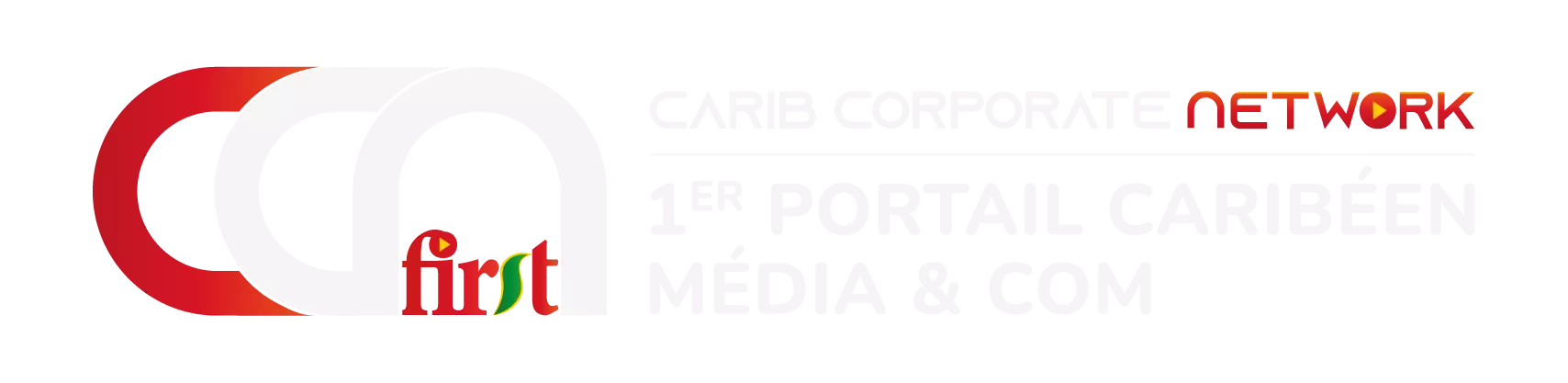














J’adhère pleinement à cette philosophie politique