
Guadeloupe. Pas de souveraineté alimentaire sans terres agricoles en quantité et en qualité
Pointe à Pitre Mardi 17 juin 2025.CCN . Depuis quelque temps, le mot de souveraineté alimentaire est dans la bouche de nombreux acteurs politiques, associatifs et professionnels. La prise de conscience commence à se développer aidée très certainement par l’augmentation considérable des prix des denrées alimentaires. Dans cette série d’articles que nous avons commencé il y a quelques semaines, nous tenons à insister cette fois-ci sur un autre pilier essentiel : les Terres agricoles !
Par Pamela Obertan
Partagez sur
Partagez sur
100.000 hectares de terres agricoles pour nourrir notre peuple.
En effet, on le sait pour produire il est essentiel de disposer de terres agricoles et donc de surfaces suffisamment importantes pour espérer nourrir notre peuple. Par exemple, si l’on souhaite que plus de la moitié de notre alimentation provienne de notre territoire, il va nous falloir des terres pour produire des denrées. Des approximations ont été faites pas certains spécialistes qui estiment qu’il nous faudrait à peu près 100 000 hectares de terres agricoles pour nourrir toute notre population[1]. Or, le dernier recensement de 2020 évalue notre surface agricole utilisée à 31 800 hectares ce qui est très loin des 100 000 hectares. D’ailleurs, une autre étude avait observé ceci « la Guadeloupe a vu son potentiel productif diminuer de façon drastique entre 1981 et 2013. En effet, sur cette période, la surface agricole utile a été quasiment divisée par 2 (57385 ha en 1981 contre 30965 en 2013) tandis que le nombre d’exploitations a été quasiment divisé par 3 (18 957 en 1981 contre 6 976 en 2013). Cela équivaut à une perte de 825 ha et de 374 exploitations par an sur la période »[2]. La perte de plus de la moitié de notre surface agricole en trois décennies est préoccupante pour l’avenir !
Cette tendance se confirme comme l’indique l’enquête Teruti qui conclut que la Guadeloupe perd en moyenne 832 ha de terres agricoles par an (-1,7 % par an) sur la décennie 2008 – 2018.
Le dispositif KaruCover qui permet grâce aux prises des vues aériennes de suivre l’évolution de l’occupation du territoire montre que « la perte de surfaces agricoles s’est faite majoritairement au profit de l’urbanisation. Entre 2004 et 2010, la surface urbaine gagne 2 525 ha nets dont 62.6 % (1 580 ha nets) d’origine agricole, le reste étant d’origine naturelle. Entre 2010 et 2017, 1095 ha nets sont urbanisés dont 77,2 % (845 ha nets) d’origine agricole »[3].
Et effectivement, nous n’avons qu’à nous promener dans notre archipel pour voir sur d’anciennes terres agricoles des nouvelles zones commerciales poussées comme des champignons ainsi que des logements, des bâtiments administratifs, des hôpitaux flambants neufs. Toutes ces constructions nous fragilisent dans notre quête de souveraineté alimentaire. En effet, à la place de terres agricoles plus ou moins fertiles on retrouve du béton. Par conséquent, tout le travail millénaire des micro-organismes pour créer cette couche d’humus nous permettant de faire de l’agriculture, disparait pour de bon avec l’artificialisation et la bétonisation des terres agricoles. Cette frénésie de construction de bâtiment de toute sorte est d’ailleurs incompréhensible alors que notre population diminue. Ce faisant, nous accentuons notre vulnérabilité en perdant nos terres agricoles alors que le système alimentaire mondial dont nous dépendons à plus de 80 % pour notre alimentation présente de signaux de détresse (perte de terres arables, diminution des agricultures, diminution des rendements, sécheresse, évènements climatiques intenses). Le risque si nous poursuivons dans cette voie est qu’un jour nous irons au supermarché et nous nous retrouverons incapables d’y acheter quoique ce soit tant les prix seront élevés ou qu’il n’y aura plus rien.
Le simple bon sens nous encourage dans un tel contexte de crises et d’incertitudes de ne pas dépendre de l’extérieur et de la grande distribution pour se nourrir. D’ailleurs, la première ministre de la Barbade et présidente de la CARICOM, Mia Mottley dans un message adressée récemment à la communauté caribéenne rappelle que les économies caribéennes dépendent largement des importations et notamment des produits américains. Or les récentes annonces de Donald Trump évoquant une hausse des tarifs douaniers risquent d’augmenter de manière substantiel le coût de production de tout de ce que consomme les Caribéens (nourriture, vêtements, voitures, construction, téléphonie…). Elle préconise donc parmi 4 grands axes de solutions de dynamiser la production locale et l’agriculture en achetant les produits aux mains des agriculteurs et non dans les supermarchés.
Cette proposition doit faire écho chez nous mais pour acheter des denrées alimentaires locales encore faut’ il avoir des terres agricoles ! Il est donc plus que temps de lancer un vaste plan pour préserver ces terres.
Aujourd’hui, plus que jamais nous avons besoin de politiques publiques innovantes et ambitieuses pour conserver nos terres agricoles. Grâce aux nouveaux outils, nous pouvons savoir assez clairement de combien de terres nous disposons. L’un des points positifs est que nous disposons de plus de terres agricoles que les chiffres officiels ne le disent. En effet, l’étude satellite de nos sols avec Karu cover met en évidence un total de 49 390 ha de surfaces agricoles, soit 30 % du territoire pour 2022. C’est une chance que nous devons conserver !
Conserver les terres agricoles
Alors parmi les principales mesures pouvant être prises l’une semble évidente : une terre agricole doit le rester.
A cet effet l’idée qui avait germé dans les services à Saint François sous le défunt Bernier d’une zone agricole protégée pourrait être très pertinente. Ce classement dans la ZAP permet de protéger les terres cultivées de l’urbanisation et de limiter les effets de la spéculation foncière. Elle offre une protection durable de la vocation agricole de certains territoires[4]. Ainsi toutes nos terres déclarées agricoles pourraient être classées en ZAP ce qui interdirait toute construction dans les terres agricoles. Nous aurons ainsi bâti un sanctuaire agricole pour les générations futures.
Ensuite, nous devons prendre à bras le corps le problème de l’augmentation fulgurante de non-exploitation de terres agricoles. En effet grâce aux dernières études, la base Karu cover a relevé qu’en 2004 on comptait 1 836 hectares de terres non-exploitées. Or ce chiffre n’a eu de cesse d’augmenter pour atteindre 3 760 ha en 2010, 5 113 ha en 2017 et 5 595 ha en 2022 ! Ce sont les communes de Grand-Bourg, Capesterre-Belle-Eau, Port-Louis et Anse- Bertrand qui sont le plus touchées par ce phénomène. Ce problème doit être pris très au sérieux, car qui dit terres non exploitées dit aussi terres plus facilement propices à l’urbanisation et à la spéculation. Des quantités importantes d’hectares agricoles peuvent de nouveau être perdues au profit de l’urbanisation et la spéculation si rien n’est fait.
Il serait utile dans un premier temps de comprendre les motifs de la non-exploitation de ces terres agricoles. Ensuite dépendamment des raisons ; on pourrait installer des jeunes agriculteurs sur ces terres. Cela permettrait de les conserver, de les entretenir et d’augmenter la production locale.
Changer les mentalités
Une autre mesure me semble essentielle c’est un changement de mentalité. Nous devons prendre conscience que nous sommes dans un archipel assez petit et non sur un vaste continent. Il me semble donc important d’arrêter de se croire dans un « far-west » à repousser les limites et de construire des bâtiments administratifs ou commerciaux sur des terres agricoles. Pourquoi ne pas améliorer l’existant au lieu de créer du neuf à chaque fois ? N’oublions pas que dans cette période de chaos climatique, le littoral risque de s’amenuiser fortement voire de disparaître. Or une bonne partie de notre population habite près du littoral. Il faudra penser à loger ces personnes. Il est donc plus que jamais fondamental d’élaborer nos plans locaux d’urbanisme avec sobriété et prudence en pensant au lendemain.
Avoir des terres agricoles saines
Si l’on arrive à préserver nos terres agricoles et à les sanctuariser cela serait bien mais insuffisant. En effet, à quoi cela sert d’avoir des terres agricoles si elles sont polluées, infertiles et en mauvais état. Nous devons donc avoir des terres en quantité pour atteindre la souveraineté alimentaire mais aussi en qualité. Or justement on le sait, l’agriculture intensive promue pendant des années par les politiques publiques agricoles a contribué à appauvrir les sols. Ces sols ont été détériorés par des années d’engrais, de pesticides en tout genre ce qui a contribué à détruire la biodiversité du sol mais aussi à diminuer sa fertilité. Atteindre la souveraineté alimentaire implique donc de prendre soin des sols, d’utiliser des pratiques agro-écologiques capables de nourrir leurs sols sans produits chimiques. Cela nécessite de mener de nombreuses études sur nos sols pour connaître leurs états de pollution, de fertilité et ensuite apporter les mesures correspondantes pour y remédier. Il sera important d’intensifier les collaborations avec les organismes de recherche et les agriculteurs pour trouver les meilleures solutions pour dépolluer les sols contaminés et stimuler leur fertilité.
Planter partout où nous pouvons
En plus des deux principales mesures précédemment énoncées : la préservation du foncier agricole et de la santé des sols il faudra faire preuve d’imagination et d’ingénierie pour couvrir tous les besoins de notre population. A cet effet, deux axes doivent être privilégiés.
Le premier consisterait à planter partout où nous avons un peu de terre. L’idée pourrait se concrétiser par le biais des jardins partagés. Pourquoi ne pas les installer dans les dents creuses d’espaces urbanisés ? Cela serait l’occasion pour nos villes de changer et se transformer en des villes jardins par exemple. La Nature pourrait ainsi revenir en milieu urbain. Tous ces ilots de verdure et nourriciers ont de nombreux bienfaits. Ils participent à la réduction des îlots de chaleur, au recyclage des eaux de pluie qui serviront à arroser le jardin, à la captation de carbone et la production d’oxygène tout en satisfaisant les besoins nourriciers d’une partie de la population.
Ensuite les particuliers ayant de l’espace, de grands jardins pourraient louer leurs terres à des jeunes agriculteurs. Il est aussi possible d’imaginer un programme pour inciter les particuliers ayant de grandes surfaces de mettre leurs terres à la disposition d’un organisme qui se chargerait de créer des jardins, de vergers… On pourrait imaginer qu’une partie de la récolte soit distribuée entre les propriétaires et cet organisme qui pourrait redistribuer les denrées alimentaires à un public précaire (chômeurs, étudiants, personnes âgées isolées, familles monoparentales). Et pour les habitants ne disposant pas de terres ou en très faible quantité il est possible de cultiver en pot avec des résultats très concluants comme l’a montré Yvon Joseph.
Nos pêcheurs à la rescousse
Un autre axe serait aussi de faire appel à nos pêcheurs notamment pour couvrir nos besoins en protéine. Toutefois, des mesures devront aussi être prise pour préserver ce secteur car la population est vieillissante, peu de jeunes prennent la relève, le nombre de navire diminue. Il est donc urgent aussi d’agir pour préserver cette profession
Développer la coopération dans la Caraïbe
Le dernier axe consisterait à renforcer nos liens avec nos voisins de la Caraïbe afin d’échanger avec eux et de compléter notre production comme l’ont fait nos ancêtres amérindiens.
En conclusion, nous avons besoin d’agir dans cette décennie si nous voulons conserver des terres agricoles en quantité et en qualité. Nous avons aussi beaucoup de potentiels tel que l’agriculture urbaine, les plante en pots, la pêche qui peuvent compléter notre production locale. La coopération avec nos voisins de la caraïbe doit s’intensifier également afin de nous permettre d’échanger sur les semences, les bonnes pratiques. Le travail ne manque et les chantiers sont nombreux. Cela nécessite un important travail à réaliser un peu comme celui d’Hercule nettoyant les écuries d’Augias. Mais je sais que notre peuple lorsqu’il se trouve acculé est capable d’accomplir des prodiges. Nous avons un génie guadeloupéen, alors à nous de l’exploiter avant que nos terres agricoles disparaissent et soient remplacées par des bâtiments, des centres commerciaux qui finiront par décrépir et fermer. Avant qu’il ne soit trop tard, choisissons la vie, la diversité pour affronter les crises futures et misons sur les richesses et nos terres agricoles que nous ont légué nos ancêtres. C’est le grand défi que je nous lance !
P.O
[1] Bruno Parmentier, « La Guadeloupe peut-elle vraiment nourrir sa population ? La vérité qui dérange » (12 mars 2025° ? https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/agriculture-guadeloupe-peut-elle-vraiment-nourrir-population-verite-derange-119798/? Christophe Verger, « enjeu et défis de l’autosuffisance alimentaire » (18 Mars 2025° ? https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/economie/enjeux-et-defis-de-lautosuffisance-alimentaire-en-guadeloupe-1027846.php
[2] Ozier-Lafontaine, H., Joachim, R., Bastié, J.P. et Grammont, A. (2018). De l’Agroécologie à la Bioéconomie : des Alternatives pour la Modernisation du Système Agricole et Alimentaire Des Outre- Mer, Note d’orientation sur les agricultures des Outre-Mer. Rapport de synthèse du Groupe de Travail Interdom de l’Académie d’Agriculture de France
[3] DAAF, Agreste, « Evolution du foncier agricole en Guadeloupe » (février 2025) https://daaf.guadeloupe.agriculture.gouv.fr/evolution-du-foncier-agricole-en-guadeloupe-a2068.html
[4] CEREMA, « La zone agricole protégée » (21 JANVIER 2025), https://outil2amenagement.cerema.fr/outils/la-zone-agricole-protegee-zap
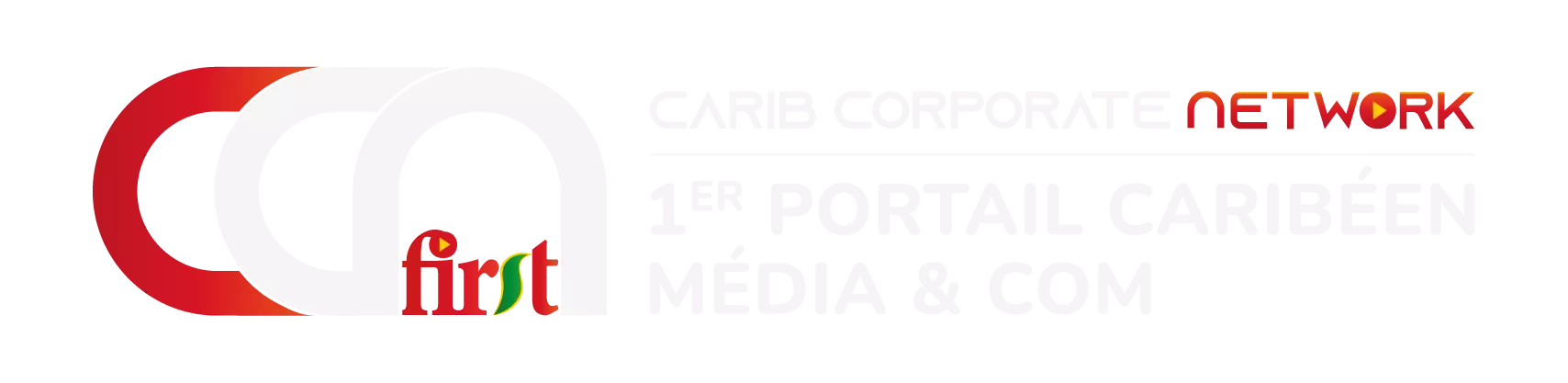














Effectivement, le constat, implacable de la diminution du foncier agricole, des exploitations agricoles et du vieillissement de la population est d’une acuité, incontestable. Je l’entends, personnellement, depuis que je suis étudiante, depuis plus de 20 ans.
– La protection du foncier agricole par la planification spatiale est un outil concret (SAR Région, SCOT : interco, PLU: Communes) : des zones agricoles strictes en vue de la mise en place de ZAP ont été définies par la Commune de MOrne-à-l’Eau sur les meilleures terres agricoles : la plaine de grippon et le foncier de belle espérance.. en concertation à l’époque avec les acteurs de la vie agricole, chambre d’agriculture, gfa, etc.. Pour autant la démarche administrative pour créer ces ZAP n’ont pas été animées.
– Une problématique inhérente à la planification est l’animation, par les maires, de leur pouvoir de police en matière d’urbanisme.
– la propriété foncière pose problème aussi : quel est le bilan de la réforme foncière animée par la SAFER ?
– Quelle est la ligne de conduite ou stratégique des plus importants propriétaires fonciers à l’échelle des communes : à qui vendent-ils ? dans quelles conditions ? et pour quels projets en définitive ? sans projet d’aménagement bouclé ou validé ? Même avec le droit de préemption, il est difficile aux Maires parfois de faire face à la spéculation foncière.
– D’ailleurs en filigrane, la question de la légitimité de la propriété foncière … post esclavagiste est également un problème de fond qui transpire via des conflits en cours opposant des soi-disant occupants à des propriétaires descendants de colons….
– Comment attirer des jeunes si ils ne sont sûrs d’en tirer un revenu correct pour en vivre , pour faire vivre leur famille ?
– produire et nourrir la population (pêcheurs inclus) c’est de mon point de vue une activité ou un métier d’intérêt général… pourquoi pas un salaire minimum ou garanti … ?
Chacun d’entre nous peut apporter une contribution concrète à l’échelle du Colibri.. tous les jours.
Notre façon de « con »sommer, .. est déjà l’opportunité d’une décision et d’un acte militant… quotidien.
L’ingénieur agronome Marcel Mazoyer proposait ( Histoire des agricultures du monde du néolithique à la crise contemporaine) depuis les années 90, « une stratégie mondiale anticrise, capable de sauvegarder et de développer l’économie paysanne pauvre, de relancer l’économie mondiale et de construire un monde vivable pour toute l’humanité »… Il était perçu comme un utopiste… il évoquait en autre la mise en place de marchés protégés à l’échelle de nos économies insulaires, avec des systèmes de tarification, de taxation, adaptés à nos échelles… il concluait son ouvrage par une devise congolaise : quand on veut grimper à un arbre, on ne commence pas par le sommet….
Il y a tant à dire et à faire
nous avons de très bonnes terres agricoles en Guadrllupe,avec des spécificités selon leurs lieux d’implantation et des capacités de productions diverses selon ces lieux.
si l’utilisation de ces sols est t bien utilisé selon ses spécificités et que nous avons des agriculteurs pour leur exploitation, nous ne serons pas loin de la suffisance alimentaire
Je rejoins tout à fait tout ce qui est dit à une exception la partie concernant la pêche. Il suffit de regarder sous l’eau avec un masque pour se rendre compte de l’état catastrophique des fonds marins et de là raréfaction de la faune . Il y a encore 20 ans les étals des pêcheurs proposaient des encore des variétés qui ont quasiment disparues. C’est triste pour cette profession mais à moins de mesures de protection drastique elle est vouée à disparaître faute de ressource. Il nous reste encore la terre qui peut nous faire vivre si nous arrêtons de la détruire.