Guadeloupe.Violences. De l’école à la rue : « Je mords ou je meurs »

Guadeloupe.Violences. De l’école à la rue : « Je mords ou je meurs »
Petit Bourg. Lundi 8 septembre 2025.CCN. Le sociologue gwadloupéyen, Ary Broussillon poursuit et approfondit avec ce 2e article son analyse sur les faits de violences récurrents qui font hélas l’actualité en Gwadloup depuis quelques années. Cette contribution a le mérite de bien expliquer les causes profondes de ces violences, qui sont entre autres la résultante d’une institution scolaire française en totale décalage avec les réalités culturelles et sociales de notre jeunesse. Nos enseignants en ont-ils conscience ?
Partagez sur
Partagez sur
“J’écoutais récemment sur TikTok les propos d’une jeune Guadeloupéenne vivant en région parisienne. Elle venait d’apprendre le décès d’un ami d’enfance, abattu par balles, et se lamentait : « Qu’est-ce qui se passe là-bas ? Tous mes amis d’enfance, avec qui j’ai fait l’école depuis le primaire, meurent sous les balles. »
Après l’assassinat d’un adolescent au Lamentin le 4 juin dernier, un témoignage recueilli par la presse illustre la profondeur du malaise : « Un garçon de 13 ans, un enfant que je voyais tout le temps, ça fait mal. Pourquoi nos enfants en sont arrivés là ? » Pourquoi ? Il faut répondre à cette question. Il faut expliquer”.
Il y a de cela quelques années, Gordon Henderson chantait avec Exile One : « Fo réfléchi avan palé, avan malpalé, avan kritiké, avan jijé, avan goumé. » Je compléterais : « Réfléchi avan aji. »
Expliquer et éclairer l’agir, c’est ce à quoi je contribue ici, modestement, à la demande de CCN Les causes de cette violence sont multiples, mais aujourd’hui, je m’intéresse aux inégalités des capitaux culturels, linguistiques et symboliques.
1/Déficit de capital culturel : lékòl-la an poblèm
Pour comprendre cette violence, il faut dépasser les faits divers et les discours sécuritaires. Il faut interroger les mécanismes invisibles qui la produisent, la nourrissent et la légitiment.
Les concepts de capital symbolique et de capital culturel, théorisés par Pierre Bourdieu, permettent de dévoiler certains ressorts de cette crise et de la montée de la violence chez les jeunes en Guadeloupe.
Le capital culturel regroupe les savoirs, les codes, les compétences et les dispositions mentales qui facilitent l’intégration dans la société dominante. Il se manifeste dans le langage, les comportements, les façons d’habiter l’espace social. Ce capital, transmis par la famille, est inégalement réparti. Un enfant dont les parents discutent, lisent, expliquent, développe plus facilement des compétences utiles à l’école. Il renvoie aussi aux compétences psychosociales : gestion des émotions, communication, pensée critique, empathie, résolution de problèmes, coopération. L’école a pour mission de renforcer ce capital.
Prenons le cas de Kevin, 15 ans, habitant de Petit-Bourg. Chez lui, pas de livres, pas de discussions sur l’actualité, aucune visite de musée ou de sites historiques. Il n’a jamais assisté à une pièce de théâtre, ni entendu parler de certaines figures historiques. Quand un professeur demande de lire un poème, il le lit comme un texte ordinaire, sans repérer les métaphores ou les registres de langue. Ses parents, accaparés par le travail ou les difficultés du quotidien, n’ont ni le temps ni les ressources pour l’aider. Kevin est curieux, mais il ignore les codes scolaires : il n’ose pas poser de questions, ne comprend pas les attentes implicites des enseignants. Il est noté sévèrement malgré ses efforts sincères. Il finit par penser que « l’école, ce n’est pas pour lui ». Il décroche, non par manque d’intelligence, mais par manque de repères.
2/L’école et le malentendu culturel
Dans les classes, de nombreux jeunes comme Kevin arrivent sans les « bons codes », sans les mots attendus, sans le bagage cognitif et culturel que l’école française exige implicitement. Beaucoup évoluent dans des familles où la lecture est absente, où l’art de l’argumentation est peu encouragé, et où la parole privilégie la spontanéité plutôt que la réflexion structurée. Ils n’ont pas appris à expliciter leur raisonnement ni à exposer une idée.
Or, l’école attend l’inverse : autonomie intellectuelle, distance critique, aisance à l’oral, souplesse dans le maniement du langage. C’est là que naît un malentendu dramatique qui mène à l’échec.
Prenons Thomas, dans la même classe que Kevin. Il vit avec deux parents diplômés, actifs dans des secteurs intellectuels. À la maison, on débat souvent d’actualité, de littérature. Il est habitué à argumenter, nuancer ses propos, citer des exemples. Lorsqu’un professeur lance un débat sur la liberté d’expression, Thomas intervient avec aisance, cite des événements, utilise des mots comme « nuancer », « relativiser », « enjeu démocratique ». Les enseignants le valorisent, l’encouragent, lui confient des responsabilités. Il est vu comme « mature » et « brillant », sans nécessairement avoir plus travaillé que Kevin.
Ce capital culturel lui permet non seulement de réussir, mais aussi de se sentir légitime dans l’univers scolaire.
En réalité, l’école ne compense pas les inégalités de départ : elle les reproduit, parfois les amplifie. Ce capital, lorsqu’il fait défaut, devient source d’inadaptation ». Le jeune privé d’un langage structuré ne dispose pas d’un outil essentiel pour résoudre ses conflits sans violence. Il ne sait pas expliquer sa frustration, négocier, verbaliser son sentiment d’injustice. Alors il crie, tape, explose. Une remarque devient une blessure. Une humiliation scolaire se transforme en rage sociale.
3/Le langage comme outil de désescalade
Je suis de ceux qui pensent que l’école devrait être un lieu de rattrapage, de réparation, de promesse tenue. C’est ce que défendait Cyrille Serva, philosophe guadeloupéen, qui affirmait que :les jeunes violents qu’il côtoyait ne manquaient pas d’intelligence, mais de mots. Et sans mots, la pensée se rétracte, se simplifie, se radicalise.
Pour lui, le langage est la condition de la pensée, et la pensée celle de la désescalade. Un jeune qui ne maîtrise pas le langage ne peut exprimer ses émotions, ses colères, ses frustrations de manière élaborée. La parole ne peut plus servir de médiation. Il ne reste alors que le passage à l’acte, parfois jusqu’à l’arme.
Ainsi, un conflit banal dégénère en bagarre parce que les élèves n’ont pas les outils linguistiques et cognitifs pour désamorcer la tension.
J’entends encore Cyrille Serva lors d’une de ses conférences, plaidant et surtout tonnant avec l’art oratoire qu’on lui connaissait, pour que l’école redevienne un espace de conquête du langage : un lieu où l’on apprend à nommer le monde pour mieux le comprendre, à nommer ses émotions pour mieux les apprivoiser, à nommer l’autre pour mieux le rencontrer. Cela suppose de valoriser la parole libre, les débats, et d’initier très tôt les élèves à la philosophie, au raisonnement logique, à l’affrontement des contradictions sans violence.
4/L’école, lieu de blessure symbolique
En Guadeloupe, pour des milliers de jeunes, l’école est le premier lieu de blessure symbolique et d’infériorisation. Non pas par méchanceté des personnels, enseignants souvent engagés et bienveillants malgré des conditions difficiles, mais parce que le système éducatif ne reconnaît pas les inégalités de départ. Il se prétend neutre et impartial, mais sélectionne selon un capital culturel normé qu’il valorise.
Au lieu d’être un rempart, l’école devient trop souvent un amplificateur de l’exclusion culturelle. Elle parle une langue que les jeunes ne comprennent pas, valorise des références qu’ils ignorent, trie, classe, note, mais ne répare pas suffisamment.
Le jeune comme Kevin, qui ne comprend pas les consignes, échoue aux évaluations, n’est jamais valorisé, finit par intérioriser l’idée qu’il est « nul », voire « inapte ». Il sent qu’il n’est pas à sa place, que son langage, sa culture, son corps même dérangent. Il ne maîtrise pas les attendus, ni les règles implicites : ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qu’il faut savoir pour réussir. Dépourvu du capital culturel valorisé par l’institution, il se cabre, résiste, se défile ou défie.
Il décroche. Et ce décrochage est autant affectif qu’intellectuel. En 2023, l’académie de Guadeloupe recensait 1 737 élèves décrocheurs. Ces jeunes quittent l’école sans diplôme, souvent en situation d’illettrisme, avec une perte de confiance, une mésestime de soi, et une colère qui monte.
Et que font le rectorat, les élus, les institutions ? Trop souvent, ils maquillent l’échec derrière des indicateurs administratifs. Ils préfèrent des statistiques flatteuses à un diagnostic sincère.
5/La rue, théâtre d’une guerre symbolique
Ces jeunes décrocheurs ne rejettent pas seulement le savoir, mais le cadre lui-même : l’institution, la société. C’est là que la rue intervient, offrant au jeune désorienté un capital symbolique de substitution.
Le capital symbolique désigne la reconnaissance sociale. Il repose sur les capitaux culturel, économique et social, qui lui confèrent légitimité. Contrairement au capital culturel, il existe uniquement dans le regard des autres. Ceux qui en sont privés se retrouvent méprisés, invisibilisés.
Kevin, dont la famille manque de ressources économiques, sociales et culturelles, est disqualifié d’emblée dans la compétition scolaire. Non pas parce qu’il est moins intelligent, mais parce qu’il n’est pas outillé de la même manière.
Il vit l’échec scolaire comme une condamnation sociale. Privé de reconnaissance à l’école, il cherche un autre espace pour exister. La rue l’attend, lui ouvre les bras. Il y trouve ses pairs, des règles brutales mais lisibles, un capital symbolique fondé non sur les savoirs scolaires, mais sur la force, la réputation, la transgression.
6/La rue comme espace de reconfiguration identitaire
Quand les institutions échouent à reconnaître les jeunes, quand l’école les exclut, quand la famille est fragilisée, quand les promesses républicaines sonnent creux, la jeunesse se tourne vers d’autres espaces de socialisation. La rue, le quartier, les réseaux sociaux deviennent des lieux de reconfiguration du capital symbolique.
Ce que l’on ne peut obtenir par les voies légitimes, comme l’école, se conquiert par des formes alternatives de prestige. Dans ces univers parallèles, la reconnaissance ne passe plus par la maîtrise du langage académique ou la réussite scolaire, mais par la capacité à imposer sa loi, à tenir son rang, à susciter la peur ou l’admiration.
« On ne nous respecte pas, alors on va faire du bruit, forcer le respect par la peur. » Le respect se gagne par la force, la transgression, la visibilité. Ici, le capital symbolique local repose sur des actes audacieux : défis à l’autorité, vols, bagarres, buzz sur les réseaux sociaux. Une vidéo violente devient un capital symbolique numérique, valorisant celui qui « n’a peur de rien ». La réputation de « bad boy » devient un signe de prestige, remplaçant les titres scolaires ou professionnels inaccessibles. C’est la revanche des dominés.
La rue devient productrice de capital symbolique, essentiel à la construction identitaire. Le jeune en difficulté scolaire, assigné au statut de « cancre », se replie sur lui-même ou perturbe les cours pour masquer ses lacunes. Il insulte l’autorité pour affirmer une compétence qui ne vaut rien à l’école, mais qui est valorisée dans son quartier.
7/Deux écoles, deux mondes
La rue, en Guadeloupe comme ailleurs, n’est pas seulement un lieu physique. C’est un espace social, un théâtre où se rejoue la question de la reconnaissance. Ce que l’école refuse de valoriser, la force, la débrouillardise, le style devient ici monnaie d’échange.
La rue devient un espace de guerre sociale, silencieuse mais brutale, entre ceux qui ont les codes légitimes et ceux qui les réinventent. Les armes ne sont pas seulement des outils de destruction : elles sont des signes de pouvoir, des objets de reconnaissance, des symboles de statut.
Ce que le jeune perd à l’école en capital culturel, il tente de le compenser dans la rue en capital symbolique, parfois les armes à la main. Mais ce capital est instable, précaire, dangereux. Il exige sans cesse de prouver sa « valeur » : par un acte de violence, une vidéo virale, un défi à l’autorité. La violence devient performative. Dans la rue, on devient « quelqu’un » par la visibilité, non par l’accumulation de savoirs. Les réseaux sociaux amplifient cette logique : le « like » remplace la note, la viralité supplante la reconnaissance institutionnelle.
Cette subversion du capital symbolique révèle un désordre social profond. La jeunesse populaire ne rejette pas la reconnaissance, mais les formes de reconnaissance qui lui sont refusées. Elle invente ses propres codes, hiérarchies, rites d’initiation.
Bien sûr, cela expose à la prison, à la mort. Mais pour beaucoup, mieux vaut être craint que méprisé. Mieux vaut régner sur un rond-point que disparaître dans une salle de classe. Oui : je mords ou je meurs. Je choisis de risquer la mort pour ne pas mourir socialement.
8/Une bifurcation systémique
Ce basculement de l’école à la rue n’est plus marginal : il est devenu systémique. L’école produit des citoyens en devenir, mais aussi des exclus en puissance. La rue capte ces énergies laissées en jachère, les transforme en puissance brute, parfois destructrice, souvent autodestructrice. Ce n’est pas une fatalité, mais une réalité.
Deux matrices éducatives concurrentes se dessinent :
- L’école républicaine, affaiblie, déconnectée des réalités sociolinguistiques, inadaptée aux codes culturels locaux, en perte de prestige.
- L’école de la rue, inversée mais codifiée, avec ses règles, ses hiérarchies, ses récompenses, ses sanctions, ses modèles.
Entre les deux, les jeunes tranchent souvent en faveur de celle qui les valorise. Même toxique, cette reconnaissance répond à un besoin fondamental : celui d’exister. Ce n’est pas que la rue soit meilleure, mais elle reconnaît, elle légitime, elle donne une place.
La violence n’est pas une fatalité, mais le produit d’un système qui fabrique du silence, de la honte, du rejet. Elle est une stratégie d’accès à un capital symbolique refusé. Une réponse à l’invisibilité. Une revanche sur l’humiliation.
Enfin, cette errance des jeunes révèle aussi la perte d’autorité des figures traditionnelles, enseignants, prêtres, élus, anciens militants perçus comme « hors-sol » ou « vendus au système ». Les jeunes, ne se sentant ni représentés ni compris, se tournent vers d’autres figures : rappeurs, « grands frères », influenceurs, parfois trafiquants.
Alors, quelle réponse porter ? J’y reviendrai.
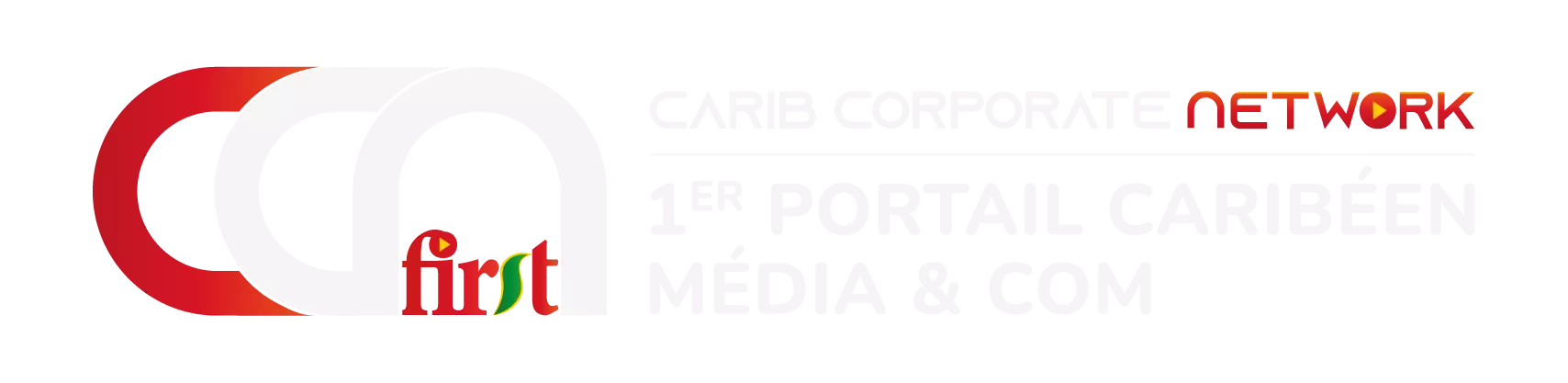














Merci infiniment ❤️ On ne peut être plus clair!
Très belle et profonde réflexion.
Un état d’esprit qui existe depuis des décennies. J’ai été victime de ces faits et bien d’autres enfants aussi . Malheureusement dans cette ère les réseaux sociaux facilitent cette vision sur la montée des injustices donc de la violence. Continuons nos réflexions et cheminons vers un apaisement social .
Merci
Une très bonne analyse de la situation de notre jeunesse guadeloupéenne. Chacun de nous devrait prendre conscience et pouvoir porter une pierre pour porter nos valeurs comme un étendard.
Jénè pa péd ka manké an rekalibrawj an konsyens
bel article, bien structuré, rend compte de la réalité de la violence en mettant en lumière le processus de gradation.
En effet la rue prend le relais des défaillances du système institutionnel, il s agit d exister et d’être reconnu en tous cas estimé, il en va de la dignité de l’ être humain.
nous sommes énergies à canaliser à transformer, dit on que la nature a horreur du vide
Merci pour ce beau papier
Lumineuse ton analyse !
En un mot :
« Tout tan nou ké rèsté Fwansé ,tchou an nou ké fann « jusqu’à zombification!
Quelle alternative ?
Faut -il répéter comme Tiken Jah :
« Quand on est nu, même au Diable, on souhaite la bienvenue !
Souhaitons que ce système s’asphysie par ses propres contradictions.
En attendant, dénonçons, en essayant de nous protéger…
Je crois que CCn c’est le » remède » que nous Caribeens devons prendre pour nous aider à réfléchir , comprendre et solutionner les problèmes ou défis de notre quotidien.
très bonne analyse. j’ajouterais le fait que le centre des arts de Pointe à Pitre haut de culture qui n’a pas eu son pareil tarde à revoir le jour. les bibliothèques avec leurs et implantations sont-elles adaptées.
Je mords ou je meurs. En effet bonne analyse sur les causes et les conséquences. Et les parents dans tout ça ?
Merci de me faire partager tes constats et tes analyses sur notre jeunesse. C’est remarquable !
Une situation systémique encore plus prégnante pour nous d’une ancienne génération.
Car, la famille , première éducatrice veillait á ce que le tronc de la graine qu’elle avait enfantée, s’élève bien droit.
Les compétences sociales, civiques, comportementales font partie des programmes de l’ècole et sont très explicites dans les programmes de 2013. Qu’en est-il de leur mise en œuvre dans les classes et ce dès la maternelle?
Je ne jette pas la pierre aux enseignants qui sont pressurisés pour boucler le programme ( disciplinaire ).
Comment (ré) concilier École et Famille? Comment adapter l’École à une société en constante évolution et mutation?
Très bonne contribution à la compréhension de ces phénomènes de violence qui frappe notre jeunesse!