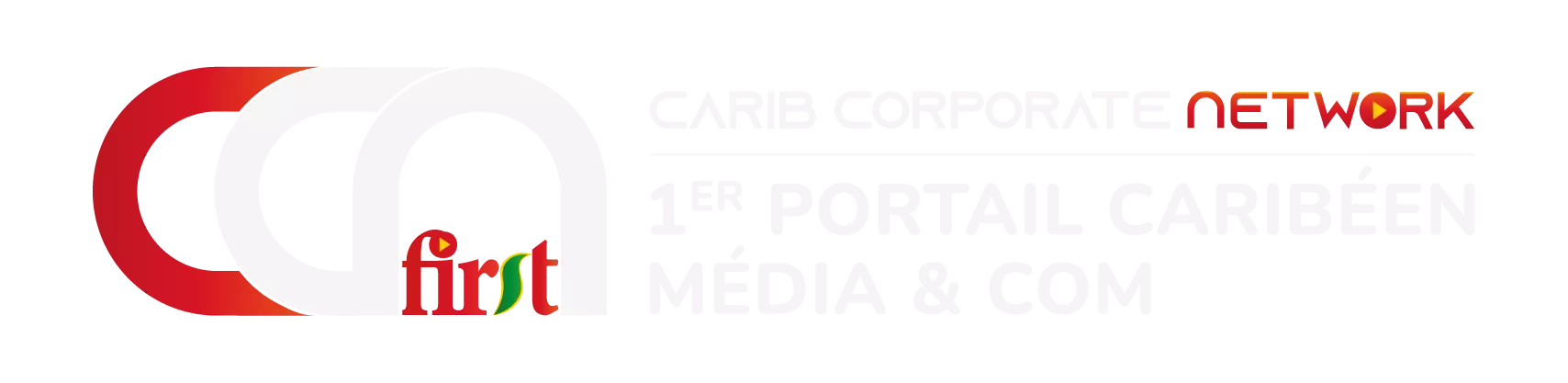Guadeloupe. Politique : Ka nou ka fé… épi yo ? (2)
Partagez sur
Partagez sur
Pointe-à-Pitre. Mardi 24 juin 2025. CCN. Dans une Guadeloupe tiraillée entre inertie institutionnelle, changement statutaire, malaise social et quête de sens identitaire, Fred Deshayes, juriste, maître de conférence en droit public à l’université des Antilles, dénonce une classe politique incapable de penser l’émancipation, un débat public atrophié, et une société trop souvent résignée aux miettes d’un système d’assistanat soigneusement entretenu par l’État français. Pour lui, si l’idée d’indépendance recule, ce n’est pas par défaut de légitimité, mais faute d’un projet clair, d’un discours courageux et d’un véritable travail de conscientisation populaire. Derrière les discours pou fè moun dòmi du «pragmatisme», il pointe une stratégie de fuite face aux enjeux de souveraineté. Un appel à rompre avec les illusions, à reconstruire une ambition nationale, et à rallumer le feu d’un projet guadeloupéen ancré dans le réel et tourné vers l’avenir. C’est à lire…

Fred Deshayes
CCN. Pensez-vous que la classe politique guadeloupéenne – y compris les autonomistes et les indépendantistes – soit aujourd’hui prête, en termes de propositions concrètes en direction du peuple dans des domaines clés comme l’économie, la culture, l’éducation, la santé ou encore la jeunesse, à assumer ou assurer une autonomie réelle, voire une indépendance, si la France venait à l’acter ?
1- « C’est la société qui doit être prête et non la classe politique »
Fred Deshayes : Il ne serait pas honnête de répondre à cette question en considérant l’ensemble de la classe politique. Certains ne veulent ni l’autonomie, ni l’indépendance, c’est donc logiquement qu’ils ne formulent aucune proposition permettant d’aller vers ces alternatives.
Pour ceux qui y sont favorables, dans les domaines de l’économie, de l’éducation ou de la santé, l’obstacle n’est pas la volonté, mais la réalité financière. Que l’on songe uniquement au montant total des salaires versés par l’éducation nationale sur un territoire où l’on réclame encore plus d’ouverture de postes, ou au coût d’un hôpital aux normes européennes avec les exigences affichées par les guadeloupéens, et on réalise tout de suite que l’activité économique du pays est insuffisante pour supporter de telles dépenses.
Pour ce qui est de la culture, ce n’est pas un domaine où il y a des dépenses obligatoires importantes (exceptées le coût des infrastructures – le MACTE par exemple requiert plus de 5 millions par an). Il faut surtout relever que ce n’est pas un domaine dans lequel l’autonomie pose problème, l’État ne mettant manifestement pas d’obstacle aux conceptions très variées des dépenses culturelles locales.
Il y a toutefois un piège dans votre question puisque vous envisagez une situation dans laquelle l’État accorde l’indépendance ou l’autonomie. Dans cette hypothèse, le peuple devrait dégager une classe politique différente qui correspond à ces situations politiques. Du coup je vous retourne la question, est ce qu’elle était prête lorsque la colonie est devenue département ? Probablement pas, mais…nous ne nous sommes pas suicidés pour autant. Est-ce qu’elle était prête lorsqu’on lui a imposé la décentralisation ou les communautés d’agglomération ? C’est la société qui doit être prête et non la classe politique. Ensuite la société produit des hommes politiques adaptés à la situation. Et c’est bien là la difficulté.
CCN. À votre avis, quelles sont les raisons principales du désengagement électoral de plus en plus marqué en Guadeloupe ?
2– Des politiques publiques inefficaces…
FD : L’abstention est en progrès partout dans le monde. Le phénomène de désaffection n’est donc pas propre à la Guadeloupe. Les causes sont nombreuses et connues. Elles résultent essentiellement de l’incapacité des politiques publiques à résoudre les problèmes concrets d’une part et à permettre d’envisager des améliorations à long terme d’autre part. Localement, c’est évident ! L’eau, le transport, l’état des routes, la lutte contre le chômage, contre la violence, le scandale à venir de l’assainissement…Quand l’action de l’État et des autres collectivités publiques ne parvient pas à satisfaire les besoins du citoyen, il se désintéresse de l’activité politique et encore plus de l’élection qui n’est qu’une procédure servant à désigner des responsables d’activités qui paraissent impuissantes à changer la vie. S’ajoute également la faible qualité du débat public local. Mais cet aspect reviendra dans une autre réponse.
CCN. Comment interprétez-vous la défiance croissante des citoyens envers les responsables politiques ?
“Au lieu de s’intéresser aux problèmes de la Guadeloupe, les journalistes vont se concentrer sur un match Lurel/Chevry puis Losbar/Chalus, sans les obliger à parler des problèmes réels du pays qui sont donc passés sous silence !”
FD : La première cause à rappeler est la faible efficacité de l’action publique. Cela donne l’impression à l’électeur que des personnes entrent en concurrence pour occuper des positions plutôt que pour régler des problèmes concrets. Une autre cause est la faiblesse du débat public en raison de la simplicité de son contenu et de ses préoccupations. A l’heure des réseaux, celui qui dit les choses les plus simples devient vite populaire. Or, les questions d’intérêt général sont de plus en plus complexes et le refus de la complexité, c’est malheureusement le pire des choix. C’est aussi vrai pour les stars des réseaux sociaux que pour les journalistes. Il faut faire vite, il faut faire simple, pas trop subtil, tout pouvoir régler en deux formules chocs en supposant que l’auditoire est médiocre et surtout en quête de médiocrité ! Dans ce contexte, les questions de fond sont évitées. Dans une campagne par exemple, au lieu de s’intéresser aux problèmes de la Guadeloupe, les journalistes vont se concentrer sur un match Lurel/Chevry puis Losbar/Chalus, sans les obliger à parler des problèmes réels du pays qui sont donc passés sous silence !
CCN. Plusieurs maires de mouvements indépendantistes ont été élus. Selon vous, ont-ils réellement contribué à faire avancer cette cause ?
3- Les élus indépendantistes piégés par le système
FD : Les maires indépendantistes n’ont pas réussi à faire avancer l’idée d’indépendance pour de nombreuses raisons parmi lesquelles on peut retenir au moins trois. La première est liée à l’idée d’indépendance elle-même qui ne bénéficie pas d’un large soutien populaire (on y reviendra tout à l’heure). Et ils n’y sont pas pour grand-chose. La deuxième c’est qu’ils n’ont pas été nombreux et qu’ils ne sont pas restés au pouvoir suffisamment longtemps pour réaliser des changements significatifs. Lorsque vous prenez en charge une commune, vous devez assumer les dépenses de vos prédécesseurs, votre marge est faible compte tenu du niveau d’endettement des communes en Guadeloupe. De plus, les programmes que vous lancez seront inaugurés lors du prochain mandat…par votre successeur si vous perdez la prochaine élection. La troisième est, pour faire simple, « le paradoxe de Marie-Jeanne ». Si vous êtes indépendantistes et que vous vous vantez d’avoir excellemment géré une collectivité publique, vous avez ensuite du mal à convaincre qu’il faut quitter le système actuel pour que le territoire soit bien géré ! L’électeur qui fait le bilan coût-avantage estime que le coût du changement est démesuré puisqu’il a déjà pour une bonne part l’avantage qu’il recherche sans investir sur un changement difficile.
CCN. D’après vous, qu’est-ce qui a freiné ou empêché les élus de faire bouger les lignes de manière significative ces dernières années ?
4– Vingt ans d’immobilisme sous couvert de pragmatisme
FD : Sur la question institutionnelle, les lignes n’ont guère bougé en raison de la période politique et en raison de la faiblesse du débat public.
Pour ce qui est de la période politique. En 2004 Victorin Lurel s’empare de la Région Guadeloupe en apparaissant le champion de ceux qui ne veulent pas de changement institutionnel. Il règne sur la vie politique durant au moins 12 ans (puisqu’il gagne 2 fois l’élection). Donc jusqu’à l’année 2016, sur les questions institutionnelles, il ne se passe pas grand-chose. C’est normal. Ensuite viendra le temps des fins de règne, pour lui et Lucette Michaux-Chevry et l’émergence de nouveaux leaders qui se distinguent en se proclamant «pragmatiques». Pragmatique par opposition à idéologique ! Puis entretemps, il y a eu l’intermède COVID. Ça fait donc bien 20 ans au moins. Le temps politique est ainsi fait. Il faut dire que pour la vie quotidienne, l’urgence n’est pas aux questions institutionnelles. Une autre cause tient au manque de débat public qui permet à l’immobilisme de prendre l’apparence de raisonnements logiques.
Par exemple, « l’économisme ». L’idée selon laquelle il ne faut rien faire si cela ne produit pas un développement économique est très fréquemment avancée. Comme il n’y a pas de lien nécessaire entre changement institutionnel et développement économique, alors cela ne sert à rien donc il ne faut pas le faire. Le défaut de cette position, c’est que la politique ou la prise en charge de l’intérêt général ne concerne pas uniquement le développement économique. A suivre « l’économisme », le droit de vote des femmes, l’avortement, l’amélioration du statut des enfants naturels, la laïcité, la liberté de croyance pour se limiter à quelques exemples sont des changements inutiles dans une société, même leur liberté d’expression se révèlerait inutile. « L’économisme » c’est le déguisement intellectuel de ceux qui ne veulent pas parler d’évolution institutionnelle sans dire leurs vraies raisons.
Une autre stratégie est comparable à celle de Pénélope. Vous vous souvenez de la femme d’Ulysse qui annonce qu’elle ne choisira un nouvel époux qu’à partir du moment où elle aura achevé de tisser ! Elle posait ainsi une condition sans rapport avec le contenu du mariage (l’harmonie des futurs époux, les sentiments), mais dont la satisfaction préalable était indispensable. Surtout, elle savait que cette condition ne serait jamais satisfaite. En Guadeloupe on vous dira que tant qu’un nombre infini de problèmes sans rapport avec l’évolution institutionnelle n’est pas réglé, il ne faut rien faire ! En prenant l’apparence grave et responsable, cela permet de reporter constamment la question institutionnelle en évoquant un nombre incalculable de questions présentées comme prioritaires. C’est habile, c’est efficace mais c’est une stratégie de fuite.
Ce ne sont que des exemples, il y en a de plus farfelus. Le débat public devrait porter directement sur les raisons et les conditions d’une évolution, et de part et d’autre, il y a évidemment des arguments solides malheureusement occultés par la faiblesse du débat public qui tourne vite aux arguments liés aux personnalités des uns et des autres…signe de vide.
CCN. Nous en sommes déjà au 19ème congrès des élus, et pourtant l’évolution institutionnelle semble toujours en suspens. Quelles en sont, selon vous, les causes ?
FD. Les dix-huit congrès n’ont pas concerné l’évolution institutionnelle. Sous l’ère Lurel notamment de nombreux thèmes comme la violence ou la jeunesse ont été abordés. Cela renvoie au temps politique et aux autres éléments évoqués précédemment.
CCN. Comment analysez-vous l’affaiblissement du mouvement nationaliste en Guadeloupe aujourd’hui ?
5- Mouvement nationaliste : “leurs projets étaient à l’évidence inachevés notamment sur les questions économiques et il était facile de montrer leur manque de réalisme”
FD : C’est d’abord l’idée d’indépendance qui est en difficulté. La diversité et le niveau de prestations sociales offertes par la politique de l’État prive l’idée d’indépendance de son soutien populaire. Les indépendantistes nés avant les années 60 ont vécu dans une Guadeloupe sans SMIC, sans RSA, sans aide aux personnes en situation de handicap, sans retraite, sans aide aux personnes âgées etc.. Allez faire campagne aujourd’hui en expliquant que vous n’allez pas pouvoir maintenir le niveau de retraite, les prestations pour personnes en situation de handicap puisque cela n’est possible que parce vous vivez parmi 58 millions de français. Ajoutez qu’il va falloir quitter la zone euro et ceux qui sont en votre compagnie vont vite comprendre que leurs investissements envisagés dans la Caraïbe ou en Afrique deviendront impossibles ! C’est donc l’idée qui est en panne.
Elle est également en perte de vitesse parce qu’elle s’appuie sur une dramatisation permanente de la violence coloniale et la rend peu convaincante. Le niveau de vie et le niveau de consommation des guadeloupéens par rapport à d’autres habitants de territoires proches ou comparables sautent aux yeux de tous (trop de voitures, trop d’alcoolisme mondain, trop de dépenses publiques inconsidérées, des querelles sur la retraite en oubliant que 95% des pays de la planète n’ont pas de système réel de retraite, des billets d’avion trop chers pour se rendre chez le colonisateur alors que les avions sont remplis…). Il y a en effet un grand nombre de problèmes graves mais il est facile de montrer qu’ils ne résultent pas de la domination coloniale. En l’absence de misère imputable à l’étranger, il faut poser l’idée sur ses fondations véritables qui sont rationnelles et politiques, faute de quoi elle se meurt.
Quant aux mouvements eux-mêmes, ils ont souffert de la concurrence des autres mouvements. Leurs projets étaient à l’évidence inachevés notamment sur les questions économiques et il était facile de montrer leur manque de réalisme. Leur fond était romantique c’est-à-dire qu’il partait de l’idée que le peuple possède une âme spécifique et immuable qu’il faut protéger de ce qui lui est étranger. On voit tout de suite le problème et les risques de dérives repoussantes ! Les mouvements présentaient une société guadeloupéenne caricaturale, agricole, négriste, fragmentée entre les riches métros et les noirs pauvres, sans mixité et sans ascenseur social. Ils faisaient la promotion d’une société recentrée sur elle-même avec une forte exigence morale. Leurs leaders étaient malheureusement confrontés aux décalages entre les pratiques réelles et ce qu’ils dénonçaient.
Depuis, le nationalisme a évolué, car ceux qui se définissent comme nationalistes veulent un drapeau, un hymne et montrer leur identité guadeloupéenne mais sans rupture avec la France. Le nationalisme de mes étudiants d’aujourd’hui est paradoxalement plus séduisant mais il n’implique aucun engagement en dehors de la culture, et la culture ; ce n’est pas la politique. Pour faire simple, les jeunes nationalistes sont de plus en plus nombreux mais ils ne sont pas séparatistes. Quelle différence faire aujourd’hui entre les nationalistes et les autonomistes ? En quoi les objectifs politiques sont différents dès lors que la rupture avec l’État n’est plus envisagée ? Ailleurs qu’en outremer cela s’appelle du régionalisme, sans plus.
Bien entendu, l’adversaire principal c’est l’État qui a une longue expérience en la matière et qui trouve encore plus facile de venir à bout de détracteurs animés par l’idée étrange et si courante en Guadeloupe que le colonisateur est plus bête que le colonisé !
Colonialiste, le mot est ronflant…mais de quelles réalités parlons-nous ? Vous imaginez vraiment une personne se plaignant d’être colonisée et avoir d’autres activités que de se libérer du joug colonial ? C’est peut-être dans ce paradoxe ou ce jeu de dupe que l’on trouve la cause véritable de la faiblesse des mouvements nationalistes contemporains.
Les titres des articles parfois provocateurs sont de la rédaction de CCN’ c’est son ADN