Guadeloupe. Notre souveraineté alimentaire : prise de conscience et mawonaj

Guadeloupe. Notre souveraineté alimentaire : prise de conscience et mawonaj
Pointe Noire. Lundi 8 septembre 2025. CCN. Comme tout début, il y a une fin. Et il nous faut conclure cette série. Nous aurions pu développer d’autres facteurs nécessaires à la souveraineté alimentaire telles que l’eau, les semences … Mais il y a un élément qui nous semble important à prendre en compte pour espérer un jour atteindre la souveraineté alimentaire : c’est la prise de conscience de la perversité du système actuel.
by Pamela Obertan
Partagez sur
Partagez sur
1. Le combat pour la souveraineté alimentaire bien au-delà de la Gwadloup
On ne peut pas œuvrer pour la souveraineté alimentaire si l’on n’a pas conscience des forces de blocages visant à empêcher les agriculteurs et les consommateurs de se reprendre en main. Le discernement et l’élévation de la conscience sont essentiels pour déjouer les pièges, voir au-delà des discours affichés et sauver notre agriculture.
En effet, notre combat pour la souveraineté alimentaire n’est pas limité à la Guadeloupe, il concerne tous les peuples. Et oui, partout dans le monde on assiste à une tendance similaire : la mort inexorable du monde agricole et la Guadeloupe n’échappe pas à cette tendance. Est-ce le fruit d’un hasard ? Certainement pas !
Si nous sommes dans cette situation c’est le fruit de décennies de politiques publiques mondiales visant à détruire l’agriculture comme on l’a connu et pratiqué depuis des millénaires pour la remplacer par une agriculture dite moderne utilisant des produits chimiques, engrais et machines. Ces politiques ont ainsi permis l’entrée d’acteurs devenus milliardaires et extrêmement puissants et qui aujourd’hui s’opposent à tout changement.
Afin de bien comprendre ce qui se passe chez nous en Guadeloupe, revenons à un niveau plus proche : la France car nous sommes encore un de ses territoires, un « ancien confettis » de l’Empire. Il est donc fondamental de saisir ce qui s’est passé là-bas afin d’appréhender les politiques qui ont été menées chez nous. Celles-ci sont d’ailleurs le plus souvent des déclinaisons de ce qui se fait sur le territoire national.
Alors en France, la volonté de changer de modèle agricole a commencé véritablement après la seconde guerre mondiale sur l’impulsion de l’État, des industriels et de certains acteurs comme l’ingénieur agronome René Dumont[1] qui a été conseiller agricole du Commissariat général au Plan de 1945 à 1953. L’objectif était d’avoir « une agriculture instruite, équipée, modernisée, productive ». L’agriculture a été considérée comme un secteur prioritaire et a ainsi bénéficié de l’aide américaine via le plan Marshall après la seconde guerre mondiale.
Le résultat de cette politique a été très rapide. En effet, si en 1949, deux millions de chevaux de trait fournissaient encore la plupart de la force motrice utilisée dans les champs, le nombre de tracteurs made in USA n’aura de cesse d’augmenter pour atteindre 1,1 million en 1967. Pour faire la place à ces tracteurs, les ingénieurs d’Etat vont procéder à d’importantes opérations de remembrement. L’idée était de fusionner les exploitations éparpillées sur le territoire, détruire tous les obstacles à la mécanisation tel que les bosquets ou les haies. Le sociologue français Henri Madras avait averti que de telles politiques allaient détruire l’agriculture paysanne, entraîner des exodes massifs et faire entrer l’agriculture française dans l’ère capitaliste[2].
Ces prédictions se sont avérées justes car comme le souhaitaient la plupart des dirigeants français, le pays est entré dans l’ère de la production et de la consommation de masse. Ainsi en 1974, la France devient la deuxième puissance agro-exportatrice avec une production de blé, de lait, de porc, de viande en forte augmentation. Une historienne américaine Vénus Bieber a noté que la France est l’un des pays au monde où le changement de modèle vers une agriculture capitaliste et industrielle a été le plus intense et le plus rapide[3]. Ce changement de modèle qui s’accompagne d’une hausse importante de la production a fait baisser considérablement les prix des denrées alimentaires ce qui libéra des fonds pour d’autres postes de dépenses. Le pays entre alors dans une phase glorieuse mais cela eût un coût écologique et humain.
2. L’usage massif de pesticides va empoisonner pour des décennies
L’environnement a sérieusement été impacté. En effet, aveuglés par les sirènes du progrès et du profit, cette politique a entraîné derrière elle un sillon de désastres environnementaux comme l’assèchement des mares. Des auteurs comme Fabrice Nicolino considère que l’aménagement des terres agricoles a été un vrai « carnage » par exemple 17 millions d’hectares sur les 29,5 millions de surface agricole utile ont été remembrés. Rien qu’en Bretagne, 280 000 kilomètres de haies et de talus (l’équivalent de sept fois le tour de la Terre) ont été arasés entre 1950 et 1985 pour permettre la fusion des parcelles, détruisant au passage tous les êtres vivants abrités par ces écosystèmes[4]. Mais c’est aussi l’usage massif d’engrais, de pesticides brefs de véritables bombes chimiques qui vont empoisonner pour des décennies voire des centaines d’années les terres agricoles, les nappes phréatiques, les rivières, les lacs, les océans laissant derrière eux un sillage de mort.
3. L’éradication des agriculteurs
Les paysans ont aussi été les grandes victimes et les dindons de la farce. En effet, selon certains auteurs, ce changement de cap a permis l’entrée du capitalisme dans le monde agricole avec l’arrivée d’acteurs privés et puissants vendant leurs différents produits aux agriculteurs (semences, engrais, engins agricoles, pesticides…) et contrôlant petit à petit tout le système alimentaire (production, transport, distribution à la consommation…). Ce faisant comme l’explique Christophe Bonneuil, l’agriculture est ainsi passé d’un métabolisme organique à un métabolisme fossile dépendant du pétrole et des produits phytosanitaires[5]. Les petites exploitations et les agriculteurs incapables de s’adapter à cette marche forcée vers le progrès ont dû mettre la clé sous la porte.
Cette éradication des agriculteurs s’est faite en plusieurs étapes. D’abord, le suivi de ces politiques par les agriculteurs a mené à d’importantes surproductions. Cela ne posait pas trop de problèmes au début grâce au mécanisme prévu par la politique agricole commune (PAC). Ce dernier permettait aux autorités européennes de racheter et de stocker les excédents pour garantir un prix minimum aux agriculteurs. Cependant, cette politique est abandonnée dans le tournant des années 90 avec le courant néolibéral. Les agricultures européennes entrent ainsi dans l’ère de la concurrence globalisée ! Cela en est fini des protections du marché commun (tarifs douaniers, prix minimum d’entrée) ! Les agricultures européennes doivent donc rapidement adapter leurs prix au cours du marché mondial. Il en résulte une forte baisse du prix des denrées alimentaires avec forcément les grands perdants de cette évolution : les agriculteurs.
4. Le métier d’agriculteur dévalorisé
Par la suite, une véritable politique publique insidieuse s’est mise en place et elle a visé à détruire les paysans avec des prix trop faibles suivis de retraites insuffisantes pour vivre décemment, l’apparition de nombreuses contraintes administratives et environnementales, des aides non adaptées. Le métier d’agriculteurs a été dévalorisé et rendu très difficile.
On peut donc aisément mieux comprendre pourquoi la France est passé de plus de 10 millions d’agriculteurs en 1945 à 1.5 millions en 1970 et à 496 000 au dernier recensement soit 0.74% de la population française. Le nombre d’exploitations agricoles continue lui aussi sa chute en passant 416 436 en 2020 contre 1.5 millions en 1970.
Ceux qui survivent sont ceux qui se sont agrandis pour augmenter leurs volumes de production et faire face à la concurrence. La PAC a contribué indirectement à ce regroupement car pendant longtemps le système d’aide étaient calculés en fonction de la surface des terres agricoles, donc plus de surface signifiait plus d’aides ce qui a entraîné des comportements de prédation comme l’expliquent certains chercheurs[6]. Aujourd’hui, il n’est pas étonnant que la surface moyenne d’une exploitation soit de 69 hectares en 2020 alors qu’en 2000 elle était de 42 hectares. De même, la course à l’agrandissement continue si bien qu’aujourd’hui les grandes exploitations qui arrivent à dégager plus de 250 000 euros par an de Production brute standard (PBS) représentent près d’une exploitation sur cinq. Elles sont dotées d’une SAU (Surface Agricole Utile) de moyenne de 136 hectares, exploitent près de 40 % du territoire agricole et mobilisent 45 % de la force de travail agricole en France hexagonale[7].
5. Des balles de ping pong avec de l’amidon ?
Le modèle agricole français continue sa mutation avec notamment l’entrée plus pénétrante du capitalisme dans le monde agricole. Ces exploitations toujours plus grandes nécessitent une main d’œuvre agricole, des salariés permanents non familiaux faisant éloigner l’agriculture française d’une agriculture familiale et paysanne. Le risque comme l’expliquent certains auteurs est de voir se développer une agriculture sans agriculteurs avec à sa tête uniquement des chefs d’entreprise [8].
Cette intégration plus grande dans le capitalisme nous amène tout droit vers une agriculture qui évolue non plus comme une activité productrice de denrée alimentaires mais comme productrice de molécules pour l’industrie avec l’apparition du cracking alimentaire[9]. Cette procédure permet d’extraire des molécules des denrées alimentaires et de fournir l’industrie qui pourra créer de nouveaux produits par exemple des balles de ping pong réalisées avec de l’amidon extrait des céréales. Le risque est de voir apparaître un modèle agricole producteur de minerais, de matières premières prendre le pas sur une agriculture nourricière. Chose certaine est qu’actuellement, on observe que tous les éléments se mettent en place pour la promotion d’un tel modèle comme on le voit avec la progression des OGM, des brevets, l’absorption des fermes par les agro-industriels, le rachat des terres agricoles, le développement des nouvelles technologies avec l’IA censées aider l’agriculteur mais pouvant collecter des données contre lui.
Il existe donc derrière le discours politique, « anba fey » comme on dit chez nous, un système visant à détruire l’agriculture tel que nous l’avons pratiqué pendant des millénaires.
6. Le mawonaj gwadloupéyen: une agriculture de résistance
En Guadeloupe, comme à notre habitude centenaire nous avons suivi la vague mais en même temps nous avons « mawonné » le système en développant une agriculture parallèle. Celle-ci est un legs de nos ancêtres. En effet, ces derniers depuis l’esclavage ont su développer des trésors d’ingénierie transformant un petit lopin de terre attribué par le maître en un jardin créole capable de nourrir et soigner toute une famille. De même, les mawons (esclaves en fuite de la plantation) ont bien compris l’importance de développer une agriculture de résistance pour survivre. Ces deux modèles agricoles ont réussi à s’inscrire dans une autre logique en échappant à l’économie de plantation et au système capitaliste. Cet héritage nous l’avons conservé et on le retrouve dans ce que l’on nomme communément la petite agriculture ou petite agriculture familiale. Ce type d’agriculture s’appuie sur des exploitations familiales et se réalise sur des petites surfaces qui varient de moins de 2 ha jusqu’à 5 ha. La petite agriculture se caractérise généralement par une agriculture saisonnière, diverse (plusieurs cultures) et vivrière, constituée d’une main d’œuvre familiale. Ces agriculteurs sont pluri-actifs « debrouya pa péché » non organisés et œuvrant plus dans le secteur informel. Aujourd’hui, ce modèle agricole représente en Guadeloupe plus de 70% des agriculteurs alors qu’en France les petits agriculteurs ont été presque tous évincés. Est-ce une coïncidence ? Je ne pense pas, mon hypothèse est que si la petite agriculture est aussi importante en Guadeloupe c’est parce que justement elle n’a pas suivi les codes et les législations européennes et françaises. C’est grâce à sa débrouillardise, son adaptation, sa connaissance du territoire, sa méfiance des institutions, sa résistance et son indocilité aux normes étrangères qu’elle a pu perdurer.
Et c’est peut-être un enseignement que nous ont livré nos ancêtres, nos anciens et nos « petits agriculteurs » à travers cette pratique du mawonaj. Le mawonaj à l’époque esclavagiste est un acte de fuite mais aussi de résistance et surtout de création d’alternatives. Le mawonaj consiste à ne pas accepter les systèmes d’idées qu’on nous impose. Mais c’est aussi une façon d’explorer d’autres voies, d’autres pistes pour contourner des blocages. Il permet d’inventer d’autres structures, d’autres manières d’être au monde. Aujourd’hui, certaines formes d’agriculture que l’on retrouve chez plusieurs de nos petits agriculteurs et qui étaient utilisées avant eux par nos grands-parents, nos ancêtres mawons et esclaves permettent de renouer avec le sens sacré de l’agriculture, c’est à dire une manière d’être au monde, une activité qui nous permet de nous nourrir, de prendre soin de l’eau, de la biodiversité et de nos corps.
Notre « petite agriculture » n’est donc pas handicapée ou en retard par rapport au modèle européen, mais elle est bien au contraire une source d’inspiration et une voie à suivre. Elle n’a donc pas besoin de mesures pour lui faire ressembler à des modèles étrangers, des modèles qui la dénaturent. Elle a juste besoin de compréhension, de partage, de soutiens adaptés à sa spécificité mais surtout de RESPECT et de GRATITUDE pour le travail accompli !
7. Non à des modèles agro-chimiques.
Par conséquent, si nous voulons conserver ce modèle agricole, alors il nous faudra mawoner, c’est-à-dire ne pas suivre les règles imposées par l’Europe et la France si elles ne vont pas dans notre sens.
Nous avons le droit et je dirais même le DEVOIR de dire NON à des modèles agro-chimiques destructeur de notre santé et de notre biodiversité, NON à des politiques faisant la promotion d’un conformisme agricole, NON à des politiques favorisant la marchandisation de l’agriculture, NON à des politiques irrespectueuses des spécificités de nos agriculteurs et cherchant à les faire entrer dans des moules étrangers, NON à un sous financement de notre agriculture.
Et si notre NON est inaudible, alors nous avons le POUVOIR de MAWONER, de ne pas suivre de tels systèmes, d’en inventer d’autres en explorant d’autres voies à plusieurs, de faire ensemble en « bas feuille ». Nous avons des agriculteurs courageux qui tracent des chemins pour nous, ils sont vaillants, dynamiques et surtout ils ne ménagent pas leurs efforts pour nous offrir une agriculture nourricière et écologique. A l’heure où je termine cet article un de ceux-là, Félix Combes est décédé alors qu’il essayait de faire avancer son tracteur dans des conditions difficiles. Ce drame nous rappelle à quel point, les conditions de travail des agriculteurs doivent être améliorées au plus vite afin que notre agriculture puisse continuer à évoluer. Félix Combes comme bien d’autres, sont des résistants mais aussi des pionniers alors continuons leurs œuvres ! Semons partout où nous pouvons les graines de la justice, de l’écologie, de la générosité, du respect de nos agriculteurs et de l’équité afin qu’un jour lorsque les conditions seront réunies ces graines germent et deviennent une forêt luxuriante qui prendra la place des champs uniformes.
C’est l’un de mes vœux les plus chers ! Félix que ton âme repose en paix et que ton travail et ton énergie puissent nous servir d’inspiration pour un créer un monde où l’agriculture guadeloupéenne devienne l’enfant chéri d’une société apaisée en harmonie avec son territoire et sa culture !
[1] René Dumont, Le Problème agricole français : Esquisses d’un plan d’orientation et d’équipement, Nouvelles éditions latines 1945
[2] Henri Mendras, La fin des paysans, Edition Sedéis, Paris, 1967.
[3] Venus Bivar, « Agricultural High Modernism and Land Reform in Postwar France », Agricultural History, 93(4), 2019, 636–655, p. 637 et 63
[4] Fabrice Nicollino, Lettre à un paysan sur le vaste merdier qu’est devenue l’agriculture, Les Echappés, 2015.
[5] C. Bonneuil, L Humbert et M. Lyautey, « Introduction – Un renouveau de l’histoire contemporaine des mondes agricoles et des espaces ruraux », dans M Lyautey, L. Humbert et C. Bonneuil, Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle, Presses Université de Rennes, 2021, 7-20
[6] Matthieu Ansaloni et Andy Smith, L’expropriation de l’agriculture française. Pouvoirs et politiques dans le capitalisme contemporain, Éditions du Croquant, Vulaines-sur-Seine, 2021, 206 p.
[7] AGRESTE Recensement agricole 2020, octobre 2022, N. 1, https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Pri2213/Primeur%202022-13_RA2020_%20VersionD%C3%A9finitive.pdf
[8] François Purseigle et Bernard Hervieu, Une agriculture sans agriculteurs Presses de Science Po, 2022
[9] https://lareleveetlapeste.fr/les-paysans-vont-disparaitre-car-les-industriels-et-la-finance-nen-veulent-plus/
Pamela Obertan

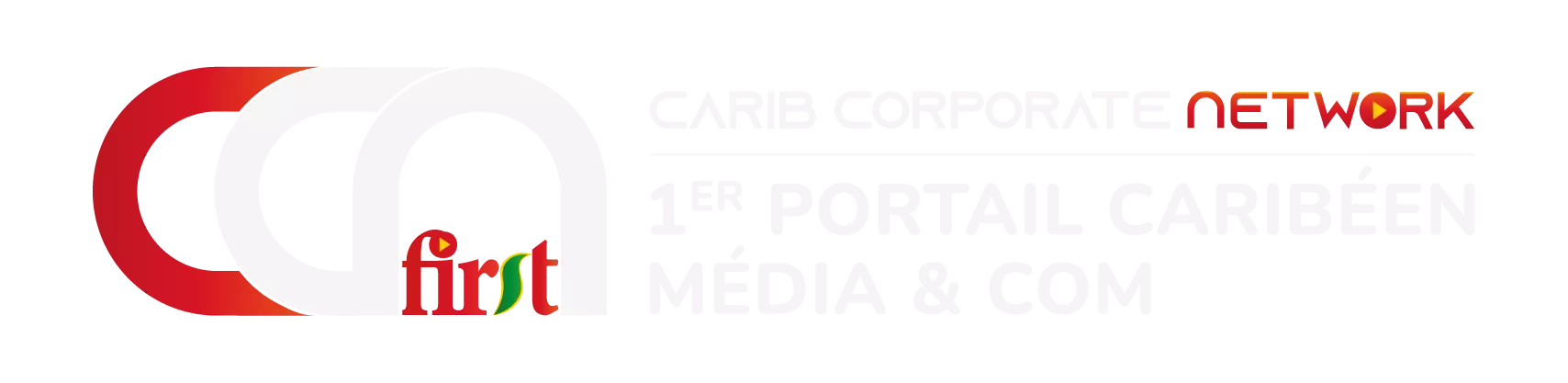














Prendre conscience de cette situation et suivre notre propre voie nous permettront de nous sauver en tant qu’être humain .il est important de penser et de decider par nous même ce qui est bon pur nous .
Bonjour, très belle analyse de la situation de l’agriculture depuis le remembrement imposé qui a entraîné la diminution des petits paysans .Seuls quelques uns ont pu acheter pour accéder à la mécanisation à outrance !.
Effectivement, aujourd’hui nous orientés vers le tout prêt sans se poser de question car la société est consommatrice. Ces produits qui nous envahissent, sont le fruit d’une agriculture chimique. Où sont nos fruits et jardins potagers derrière la maison ? Nos grands parents plantaient ce sont ils avaient besoin. Aujourd’hui nous enrichissons ces agriculteurs du temps moderne.