
Guadeloupe. L’impact de la colonisation sur la spiritualité et et les pratiques religieuses dans les îles à sucres
Baie Mahault. Mardi 8 juillet 2025. CCN Lhistoire de la Guadeloupe est marquée par la colonisation, qui a entraîné la déportation et l’esclavage de milliers d’Africains, suivis par le système de l’engagisme après l’abolition de 1848. Entre 1854 et 1889, environ 42 900 Indiens ont été transplantés en Guadeloupe pour travailler dans les plantations sucrières, avec un taux de mortalité élevé ; plus de 71% des indiens moururent dans les champs de cannes des colons. Les planteurs, ne pouvant remettre en esclavage les nouveaux libres, ont cherché une main-d’œuvre servile, et le choix des Indiens n’a pas été ni arbitraire ni une fatalité.
Partagez sur
Partagez sur
Le cas des pratiques indiennes en Gwadloup.
Par Pandit Vishnunanda (Elie Shitalou) du Sanatan Dharma Samaj de Guadeloupe avec les précieux conseils de Charles Saraye (Ile Maurice) et Olivier Mounsamy (Guadeloupe)
L’histoire de la Guadeloupe est marquée par la colonisation, qui a entraîné la déportation et l’esclavage de milliers d’Africains, suivis par le système de l’engagisme après l’abolition de 1848. Entre 1854 et 1889, environ 42 900 Indiens ont été transplantés en Guadeloupe pour travailler dans les plantations sucrières, avec un taux de mortalité élevé ; plus de 71% des indiens moururent dans les champs de ca’nnes des colons. Les planteurs, ne pouvant remettre en esclavage les nouveaux libres, ont cherché une main-d’œuvre servile, et le choix des Indiens n’a pas été ni arbitraire ni une fatalité.
Ainsi, Le Conseil Général de la Guadeloupe lors de sa séance du 4 novembre 1854 déclare que « l’immigration, c’est tout l’avenir »… Le coolie, Messieurs, a pour lui les suffrages unanimes de ceux qui l’ont employé, la sympathie de toutes les contrées intertropicales où il a paru. Le coolie est l’immigrant par excellence. Bien faite et solidement constituée, quoique fine et élégante, facile à acclimater, de mœurs douces et polies, d’un caractère doux et soumis, cette race est surtout remarquable par sa scrupuleuse fidélité aux engagements pris. Elle n’a pas, dit-on, la verve du Chinois, mais elle a au plus haut degré la religion du contrat et son travail toujours suivi, toujours correct ne laisse rien à désirer, qu’il s’accomplisse sous les yeux ou en dehors de la surveillance du maître. En outre, et jusqu’ici, le salaire du coolie est le moins élevé de tous ceux qui sont attribués aux immigrants ».
Arrivés dans un monde étranger, les travailleurs indiens ont emporté avec eux un bagage culturel et spirituel. Cependant, sous la domination de l’Église catholique, leurs pratiques religieuses ont dû s’adapter pour survivre. Ce texte vise à analyser comment la colonisation a influencé, freiné, mais aussi renforcé la spiritualité indienne en Guadeloupe.
- Objectifs coloniaux – La colonisation française a eu pour but la conquête, la recherche de ressources et la conversion religieuse. Les colons ont cherché à faire des colonisés des « Français exemplaires », entraînant une aliénation culturelle voire totale. La colonisation a eu des conséquences dévastatrices pour les populations locales, qui ont été arrachées de leurs terres.
Plusieurs siècles de colonisation plus tard et de domination, après avoir tout détruit, les européens et notamment les français viennent, en donneur de leçon, enseigner au monde le développement durable !
- Transplantation religieuse en contexte colonial – Les Indiens, arrivés en Guadeloupe, se sont retrouvés dans un environnement hostile. Leur religion
est devenue un refuge identitaire, leur permettant de maintenir un lien avec leur terre d’origine. Malgré la répression de leurs pratiques, les hindous ont continué à célébrer leurs rituels, souvent dans la clandestinité, en raison de l’hostilité de l’Église catholique, apostolique et romaine.
- Résilience, adaptation et syncrétisme – Les travailleurs indiens ont adapté leurs pratiques religieuses face aux contraintes coloniales. Des formes de syncrétisme religieux ont émergé, intégrant des éléments locaux et chrétiens. Les rituels ont été simplifiés, et des autels improvisés ont été créés en l’absence de temples. Ce syncrétisme a permis de maintenir une spiritualité vivante, enracinée dans le quotidien des engagés.
- Perte de traditions et création de nouvelles pratiques – La colonisation a entraîné la perte de certaines traditions, comme la crémation, en raison de la répression des pratiques jugées « païennes ». Cependant, les Indiens ont réussi à créer de nouvelles pratiques qui reflètent leur expérience en Guadeloupe, intégrant des éléments de la culture créole.
- Encadrement colonial et institutionnalisation religieuse – Avec le temps, l’administration coloniale a toléré certaines pratiques religieuses, mais toujours sous un contrôle social. Les chefs religieux étaient souvent perçus comme des relais d’influence, et les pratiques religieuses devenaient un marqueur de stratification sociale.
- Héritage spirituel dans l’ère postcoloniale – Malgré la répression, les Indiens ont maintenu leurs traditions et les ont transmises à leurs descendants. À partir des années 1970, un renouveau de la spiritualité indienne s’est manifesté, avec l’arrivée de la 3ème génération sur les bancs des lycées, la création des premières associations culturelles, la réintroduction de grandes fêtes et la construction de temples. Les pratiques autrefois marginalisées sont désormais célébrées publiquement. Aujourd’hui, la spiritualité indienne est un pilier de l’identité locale, influençant la culture, la cuisine, la musique, les valeurs familiales et même la politique.
Ce renforcement postcolonial montre que les pratiques religieuses et spirituelles, loin d’être effacées par la colonisation, ont su se transformer en force de résilience et d’affirmation.
En guise de conclusion – L’impact de la colonisation sur les pratiques religieuses indiennes en Guadeloupe est complexe : répression, adaptation et renaissance. Bien que la domination coloniale ait tenté d’affaiblir ces pratiques, elle n’a jamais pu les faire disparaître. Au contraire, la spiritualité est devenue un socle culturel et identitaire pour les engagés et leurs descendants, témoignant d’une force de résilience face à l’oppression.
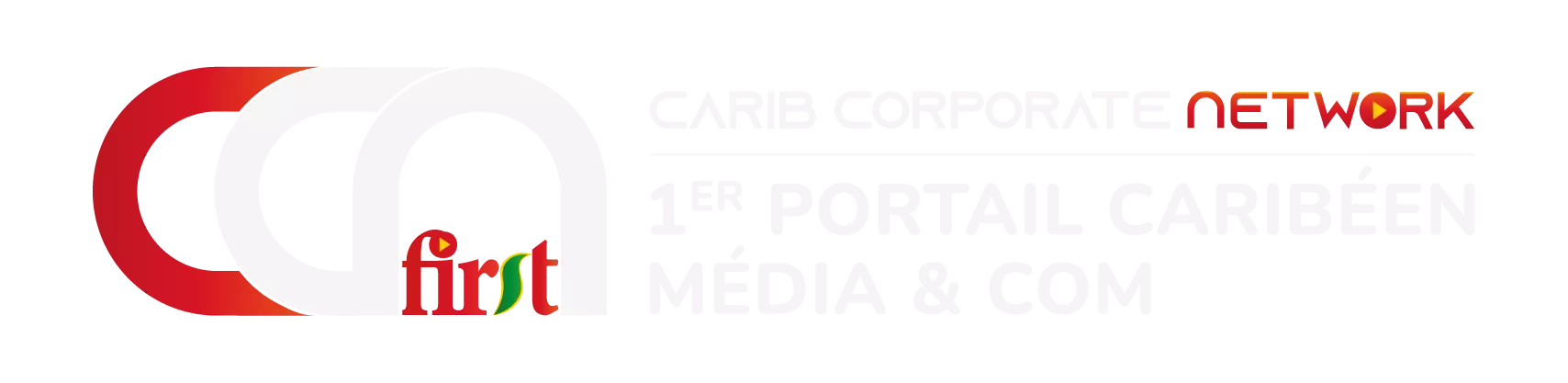















On regrettera un caractère trop général du propos.
Des pratiques religieuses qui ont connu des formes répressives et de renaissance. Oui mais encore ! De la même manière, le texte se dispense de définir ce qui est dénommé sans aucun contenu la spiritualité indienne. Est elle une ? Tous les indiens arrivés en terre coloniale partageaient-ils les mêmes croyances.
Le lecteur aurait appris davantage si l’auteur aidé des ressources citées avait pris le temps de décrire les pratiques en questions en montrant sur un ou deux exemples les transformations pointées tant du point de vue du rituel ( et de ces objets ) que des croyances elles-mêmes. Que deviennent elles dans un contexte de creolisation ? Les cosmogonies indiennes évoluent comment dans un contexte qui a déterritorialisé toutes les formes vécues du croire ?