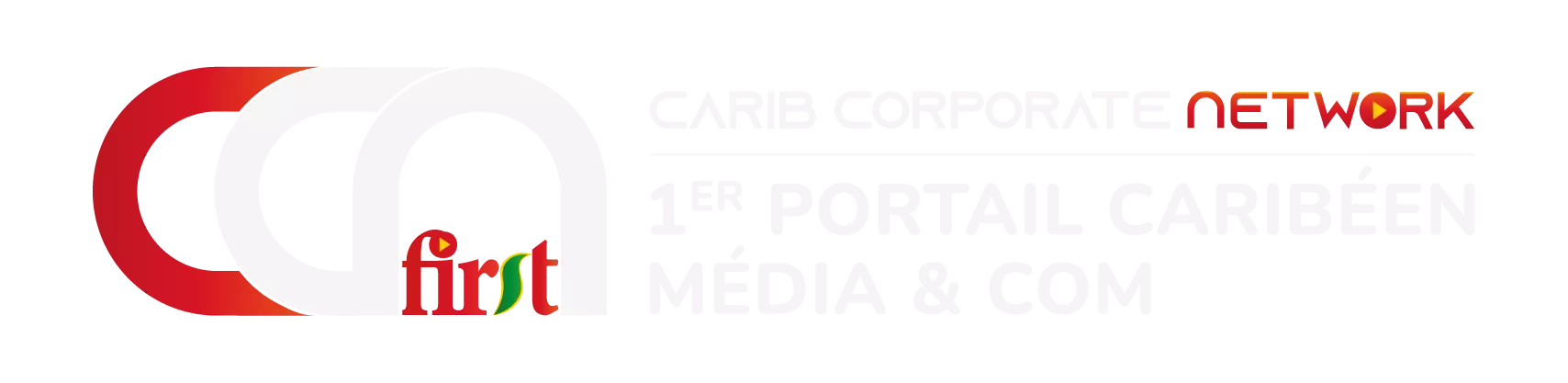Guadeloupe. Culture. Woucikam Tome 2 : De l’Égypte à la Guadeloupe, une réhabilitation de notre langue (1)
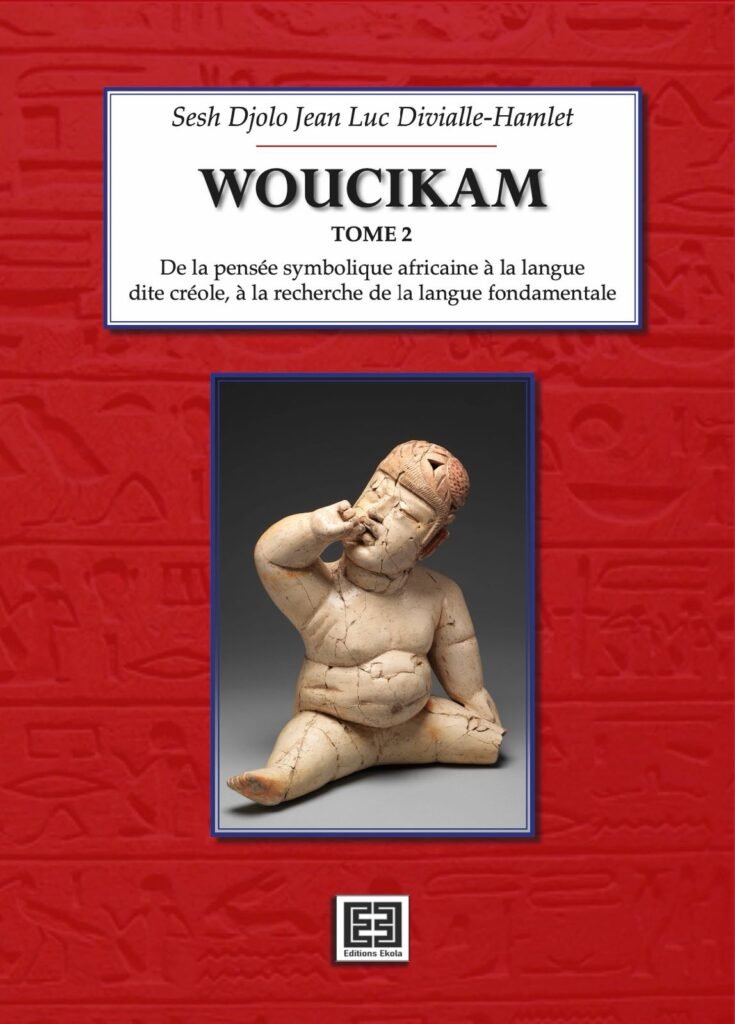
Guadeloupe. Culture. Woucikam Tome 2 : De l’Égypte à la Guadeloupe, une réhabilitation de notre langue (1)
Pointe à Pitre. Lundi 8 septembre 2025. CCN. C’est en mars 2017 que jean Luc Divialle DJolo sortait le tome 1 de “Woucikam”, un ouvrage qui a totalement révolutionné l’approche systémique que nous avions de notre langue nationale et de notre culture il faut le souligner l’approche Divialliste du kreyol a singulièrement bouleversé les créolistes qui ont du mal à accepter avec la bienveillance nécessaire le fruit de ses recherches. 8 ans après le Woucikam 2 est un pas supplémentaire d’importance. La question centrale de la pensée symbolique et les origines réelles de notre langue sont une fois de plus explicitées avec la rigueur nécessaire. La lecture de Woucikam Tome 2 nous semble indispensable. En effet, rompant avec une certaine doxa eurocentriste créole, l’auteur affirmait scientifiquement que nos origines culturelles devaient être reliées à l’antique civilisation de la vallée du Nil. Certains se sont gaussés, d’autres ont haussé les épaules. En cette année 2025, l’auteur récidive et enfonce le clou. Le tome 2 de son ouvrage sous-titré, de la pensée symbolique africaine à la langue dite créole, à la recherche de la langue fondamentale, questionne cette fois la notion de pensée symbolique et de sémantaxe et leurs incidences sur tous les peuples jadis arrachés à leur terre d’Afrique. Cette forme d’archéologie linguistique se veut aussi une réponse scientifique et fortement documentée à ses détracteurs de jadis. Pour CCN qui en a eu la primeur, cet ouvrage marque un tournant majeur.
L’interview qui suit de JL Divialle peut être considérée comme une porte d’entrée…
Partagez sur
Partagez sur
CCN. Quelles sont les nouveautés de ce tome 2 ?
Djolo : Maryse Condé disait que ce qui sert à nous décrire ne répond qu’à une “personnalité d’emprunt”. Elle disait : “Personne ne sait ce qu’est le noir. On ne connaît pas sa langue et on n’appréhende qu’imparfaitement ses dieux, ses relations avec le monde visible et invisible”. Elle ajoutait surtout : “Il nous est imposé une personnalité qui convient à l’usage que l’on veut faire de nous, et à travers un modèle qui ne peut décrire que de façon hâtive et toujours malveillante les aspects de notre vraie nature, mais que cette vraie nature en dépit de tout, contredisait largement cette personnalité d’emprunt”. Voilà précisément l’objet de ce livre. Woucikam tome 2 fournit enfin les clés de compréhension de notre langue fondamentale propres à aider chacun à déconstruire cette fausse personnalité qui nous est imposée. Il vise à restituer aux Guadeloupéens leur personnalité réelle, mais surtout démontrer leur paternité du modèle culturel bantou avec lequel s’est forgée la Guadeloupe. Woucikam tome 2, c’est donc l’ouvrage scientifique le plus riche et le plus documenté sur notre langue et notre modèle culturel. Il retrace étape après étape, les origines de notre langue et de nos traditions, de la préhistoire à 2025. Cette authentification des fait présentés a nécessité la mobilisation de plus de 350 langues africaines modernes et anciennes. Aussi, pour la première fois, nous pouvons nous prononcer en toute certitude sur notre vrai vocabulaire et nos valeurs civilisationnelles. Tout nous est rendu à partir d’une étymologie clairement détaillée. C’est donc l’ouvrage que tout locuteur de notre langue se doit de posséder. Il démontre surtout que nous sommes détenteurs d’un modèle culturel extrêmement ancien qui contredit la thèse créole et la personnalité d’emprunt qu’elle nous impose. Cette démarche reste bien évidemment identique pour les autres locuteurs de notre langue qui vivent dans la Caraïbe et l’océan Indien.
CCN : Que nous apporte l’Égypte ?
Djolo : Un peuple qui vit sous fausse identité est un peuple faible et fragile. Son identité, sa langue, son histoire, son modèle culturel sont livrés à tous les vents. Un jour on le persuade qu’il est créole et il l’accepte ; l’autre, qu’il est kalina, et il l’accepte. On lui dit que sans les autres il ne serait rien et il revendique ce fait sans que jamais aucune preuve tangible ne lui permette de contredire scientifiquement ces propagandes menées contre lui. C’est signe que sa personnalité réelle est intentionnellement gommée. Or, Aboubacry Moussa Lam disait : “Quand la tradition orale est véridique, les preuves des faits qu’elle avance se trouvent à notre point de départ”. Quel est notre vrai point de départ ? L’Égypte, nous permet enfin de répondre et de l’atteindre de façon certaine. On découvre et prouve alors non seulement que toutes ces postures identitaires sont fausses, mais elle nous permet de reconstruire notre langue fondamentale. Celui-ci, contrairement aux autres est en tout point vérifiable au moyen d’une méthode de recherche mathématique rigoureuse et donc indiscutable. Parce qu’au grand dam de nos détracteurs, l’Égypte est une civilisation lettrée à qui nous devons notre alphabet moderne. Tout peut donc être linguistiquement et anthropologiquement vérifié. Nos conclusions sont donc imparables. Et dans une perspective d’avenir, comme nulle civilisation ne saurait durer si elle se bâtit sur le sable, nous avons le devoir d’être prospectifs et comme pour toute construction sérieuse atteindre le sol dur de nos origines. Voilà ce que l’étude de la civilisation pharaonique nous apporte. Elle révèle le visage réel de notre langue et de notre culture guadeloupéenne. Elle dit tout ce que nous avons accompli grâce à notre modèle culturel africain, en 382 ans de présence effective en Guadeloupe. C’est celui-là même qui est intentionnellement enfoui sous Appellation Coloniale Contrôlée Créole (ACCC). Or, ce sont, tout au contraire, les Africains et la puissance de leur modèle culturel qui ont fait cette Guadeloupe que nous aimons et qu’on nous envie. Sans une telle prise de conscience, jamais nous ne pourrons nous émanciper de cette personnalité d’emprunt, et jamais nous n’embrasserons correctement notre destin de Guadeloupéens.
CCN : Qu’est-ce que la pensée symbolique, pourquoi est-ce aussi important pour l’étude d’une langue ?
Djolo : L’homme n’est pas né avec l’usage de la parole. C’est une conquête de la préhistoire. Elle a commencé quand il y a plusieurs dizaines de milliers d’années, dans la région des grands lacs africains, un premier groupe d’humains s’est mis à traduire son environnement en sons, puis en mots et en phrases. Mais qui en est le responsable ? C’est la logique interne par laquelle l’homme associe les idées aux mots. Voilà ce que nous appelons pensée symbolique ou encore vision du monde. En quoi est-ce important ? Cette logique interne se fixe dans le cerveau et ne disparaît jamais. C’est comme un scanner multi millénaire d’un peuple donné. La pensée symbolique consigne et témoigne donc de toutes nos habitudes, notre système de réflexion, notre syntaxe, notre culture, nos traditions, notre mode de civilisation, notre type de société politique… Ceci s’étend sur des millénaires vu qu’elle est aussi indélébile que notre ADN. Et vu que c’est une démarche biomimétique, la nature d’une pensée symbolique dépend surtout de l’environnement climatique qui a été copié. La pensée symbolique d’un peuple témoigne donc de la singularité de son caractère. C’est une signature. Ceci permet par exemple de distinguer le mode nomade du mode sédentaire. Cela signifie que les hommes nés dans un climat tempéré ne peuvent avoir la même vision du monde et le même tempérament que ceux nés sous des latitudes tropicales. Il ne peut donc y avoir à proprement parler d’Universel. Aussi, contrairement à ce qui est dit de la langue guadeloupéenne, il ne suffit pas d’assembler des mots venus de langues et de peuples divers pour construire une langue. Comme ce que le logiciel est à l’ordinateur, ce qui compte dans l’avènement d’une langue, c’est la pensée symbolique qui l’anime. Or, il se trouve qu’à l’étude de notre langue nous constations que celle-ci correspond à celle apparue dans la région des grands lacs. Cela signifie en toute logique que notre langue est africaine et que nous pouvons retracer son évolution de la préhistoire à 2025, parcours que nous exposons dans Woucikam tome 2. En d’autres termes, la seule chose dont les mots français présents dans notre langue attestent, c’est que nous sommes un pays dominé, parce qu’ils s’imposent en gommant petit à petit notre lexique initial. Cette question née à la préhistoire est très actuelle. Elle permet de mieux comprendre le choc que fut la rencontre de l’Afrique avec l’Europe, et toutes nos difficultés d’adaptation à un monde mu par une pensée symbolique occidentale distincte de la nôtre et dont nous ne cessons de subir les conséquences.
CCN : Vous parlez de vérification à partir de l’Égypte, mais comment pourrons-nous le vérifier alors que le Guadeloupéen ne maîtrise pas les hiéroglyphes.
Djolo : Woucikam tome 2 se veut également un guide d’initiation à la lecture des hiéroglyphes. Ceci permet à tout un chacun de vérifier ce que nous affirmons tout en se formant à la lecture des caractères sacrés de leurs ancêtres. Nous utilisons pour cela la méthode Kuma de Dibombari Mbock qui permet cette lecture effective à partir du copte et des langues africaines modernes dont la nôtre. Chacun constatera alors qu’à chaque hiéroglyphe correspond un mot de notre langue maternelle actuelle.
CCN : Vous dites que la rencontre avec l’occident a constitué pour l’Africain une réduction ?
Djolo : La réduction que nous avons subie n’est pas que d’ordre physique. En plus des sévices connus et les restrictions de liberté et d’habitat, nous devons absolument considérer ceux d’ordre psychologique. C’est d’abord le passage d’un système de fixation de la parole comportant plus de 3000 signes jadis en Égypte, à l’imposition d’un autre ici, n’en comportant que 26 lettres qui explique mieux cette réduction. De ce fait, la perte de liberté physique a été aussi celle de la réduction de notre capacité à décrire notre univers avec nos sons, nos mots, nos phrases. Cela signifie que notre cerveau n’était pas destiné à parler français et encore mieux à chercher à s’aligner en toute chose à la pensée symbolique occidentale. Il était voué à nous voir nous réaliser en tant que civilisation selon notre propre vision du monde africaine. Certains pourraient croire ce fait anodin, mais soyons tous conscients que nos premiers traumatismes commencent là. Beaucoup de dysfonctionnements observés chez nous et notamment chez les scolaires dérivent de ce fait. Qui comprend cela, comprend tout.
CCN : Sur quoi repose cette réduction ?
Djolo : Je crois que l’approche vers laquelle nous sommes volontairement orientés nous a tous fourvoyés. Elle nous pousse à ne toujours questionner notre histoire et notre culture que sur la courte durée, celle précisément sur laquelle repose toute l’armature du modèle créole. Aussi, dès que l’on questionne le vocabulaire de notre langue, on se réfère systématiquement aux dialectes européens. L’Afrique elle, n’est jamais sollicitée. On prétend par exemple et sans jamais scientifiquement le démontrer, que le terme Mawon provient de l’espagnol ou de l’arawak et nous le validons. Tout ceci laisse à croire que nous n’avons jamais rien produit par nous-mêmes. Or, la longue durée démontre que c’est totalement faux. Mawon est un terme qui par le concept et l’étymologie est d’abord africain. Il figure tout comme notre tim-tim dans le lexique de l’égyptien ancien et du copte. Il signifie dès cette période : “fuir”, “échapper à une situation préjudiciable”. C’est donc par cette vision à court terme eurocentriste créole qu’est déformée notre réalité en tant que peuple et que notre capacité d’initiative historique est contrée.
CCN : Quelles conséquences y voyez-vous ?
Tout ceci permet de valider l’idée que nous serions tous nés en 1848 ou que nous serions un très jeune peuple qui, dans son évolution et son élévation, serait amplement redevable aux modèles culturels des autres. Ceci permet donc d’entretenir le mythe de notre immaturité, de notre impréparation et de notre incapacité à agir en peuple majeur et surtout que cela nous demanderait énormément de temps afin d’être prêts à relever les défis de notre destin. Or tout ceci n’est qu’un leurre. Ce qu’il faut au contraire, c’est questionner le temps long. Et ce questionnement nous permet de remonter très loin dans le temps, bien avant l’avènement de l’Égypte même. C’est cette démarche seule qui restitue ce que nous sommes vraiment et que nous avons à être demain. De ce fait, ce n’est pas de de la main de l’autre que dépend notre façon de marcher. Nous sommes de fait une parcelle de ce très vieux peuple dont le modèle culturel né il y a plusieurs dizaines de milliers d’années s’est répandu de la vallée du Nil jusqu’à ces nouvelles terres où nous avons été déportés dans le monde. A suivre…