
Guadeloupe. Violences sexuelles : La honte a-t-elle changé de camp ?
Pointe à Pitre. Lundi 28 juillet 2025. CCN. C’était la question centrale posée lors d’une conférence publique organisée récemment à l’hôtel Arawak. Sur l’estrade : des magistrats, des professionnels de santé, des avocats… et dans la salle, un public venu nombreux. Une émotion puissante s’est fait ressentir pendant cette conférence, celle de pouvoir entendre, dans un cadre officiel, les mots “viol”, “consentement”, “inceste”, prononcés sans détour. Et de constater, que ce qui se taisait commence enfin à se dire.
by Imane Sioudan (CCN)
Partagez sur
Partagez sur
L’affaire Pelicot, très médiatisée mondialement, semble avoir agi comme un déclencheur. Le fait même qu’elle ait été portée publiquement a remué l’opinion et redonné de la force à d’autres victimes, souvent restées dans l’ombre.
Alors la honte s’est elle complètement déplacée?
Elle s’effrite, parfois. Mais beaucoup trop de femmes continuent à se taire, par peur, par culpabilité, ou parce que la violence a été minimisée par l’entourage ou les institutions.
Pour aller plus loin, CCN a interrogé Caroline Calbo, Procureure de la République à Pointe-à-Pitre, sur les avancées concrètes en matière de justice, les défis persistants, et l’urgence d’agir auprès des jeunes. Voici ce qu’elle nous a confié.
1/Une justice en lente transformation ?
Selon Caroline Calbo, plusieurs progrès sont en cours :
- “Les échanges fréquents entre l’unité médico-judiciaire et les services spécialisés doivent désormais permettre de limiter les blocages administratifs à la prise de plainte pour violences sexuelles.”
Un point crucial concerne aussi la prise en charge des enfants victimes d’inceste, avec la création d’une unité d’accueil pédiatrique spécialisée au CHU. Une salle d’audition dédiée, une équipe pluridisciplinaire, et un accompagnement psychologique permettent une meilleure écoute dès les premiers instants.
Sur le plan judiciaire, la procureure souligne que moins de procédures sont classées sans suite, grâce à une prise en compte élargie des preuves : “pas seulement ADN contre parole”, mais aussi des faisceaux d’indices et des témoignages.
Cependant, le manque de formation des enquêteurs et magistrats, ainsi que le sous-effectif persistant dans les brigades, ralentit encore de nombreuses procédures. La lenteur peut être destructrice pour les victimes qui attendent réparation.
2/ La parole se libère, mais reste fragile
Interrogée sur l’impact des affaires médiatisées comme celle de PELICOT, Caroline Calbo se veut optimiste :
- “Je pense que plus on en parlera, plus les victimes comprendront qu’elles ne sont pas seules à subir des violences sexuelles. Ce n’est pas à elles de porter la culpabilité, mais de dénoncer pour se réparer — et protéger d’autres victimes potentielles.”
Depuis le mouvement #MeToo, une évolution est perceptible, même si l’augmentation des plaintes reste légère. Ce sont surtout les cas visant des personnes connues ou influentes qui émergent davantage.
Mais la justice seule ne peut porter ce mouvement. C’est toute la société qui doit soutenir cette libération de la parole.
3/ La jeunesse en première ligne : entre vulnérabilité et désinformation
La partie la plus préoccupante de l’entretien reste celle dédiée à la jeunesse. Les jeunes sont à la fois victimes très fréquentes, notamment d’inceste, et auteurs potentiels, influencés par des modèles violents.
- “L’absence d’information sur leur corps, la sexualité, le respect… ou l’accès quasi exclusif à des sites pornos crée une vision brutale et déformée des relations,” explique la procureure.
Elle alerte sur la méconnaissance massive de la notion de consentement, souvent floue ou mal interprétée par les adolescents. L’exposition à des contenus toxiques, parfois relayés par des influenceurs masculinistes, alimente une culture de la domination contraire aux valeurs républicaines d’égalité.
Des actions de prévention existent dans certains établissements scolaires, mais elles devraient être systématisées à tous les niveaux. Caroline Calbo regrette également que certaines associations ou structures freinent ces interventions “pour des raisons dogmatiques”, alors même qu’elles pourraient sauver des vies.
4/ Une bataille culturelle autant que judiciaire
La conclusion s’impose : la honte commence à changer de camp, mais pas assez vite. Le silence reste encore la norme pour beaucoup de femmes, et les institutions doivent aller plus loin, plus vite, et avec plus de moyens.
C’est une bataille culturelle qu’il faut désormais mener, en particulier auprès des jeunes. Une bataille pour redéfinir la sexualité, le respect, le rapport au corps et à l’autre. Une bataille où les médias, les créateurs de contenus, les enseignants, les familles, les artistes, ont tous un rôle clé à jouer.
Briser le silence, ce n’est pas seulement dénoncer, c’est aussi reconstruire. Et pour que cette reconstruction soit possible, nous devons collectivement oser regarder la violence en face, et dire : “ça suffit.”
I.S
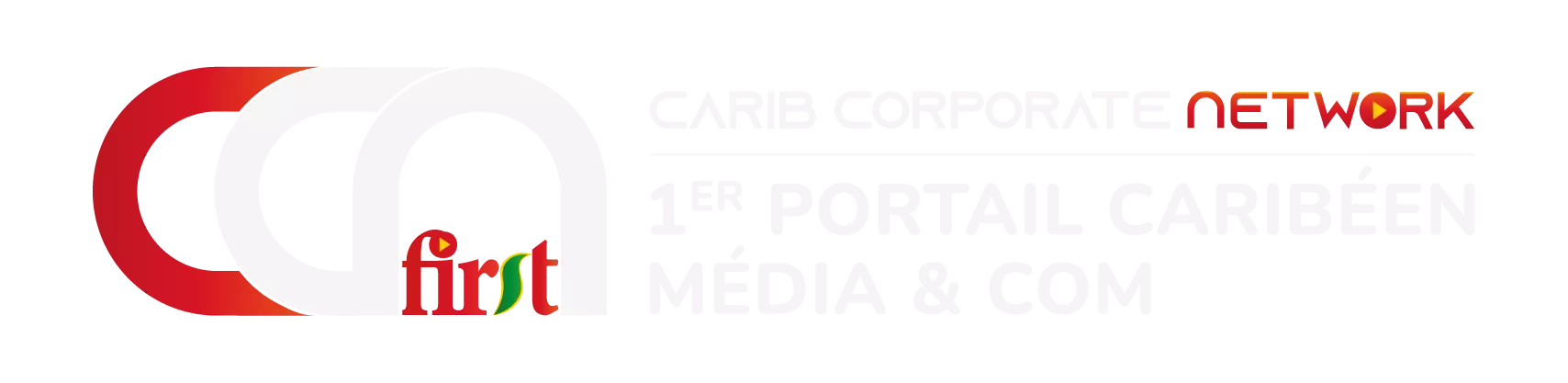


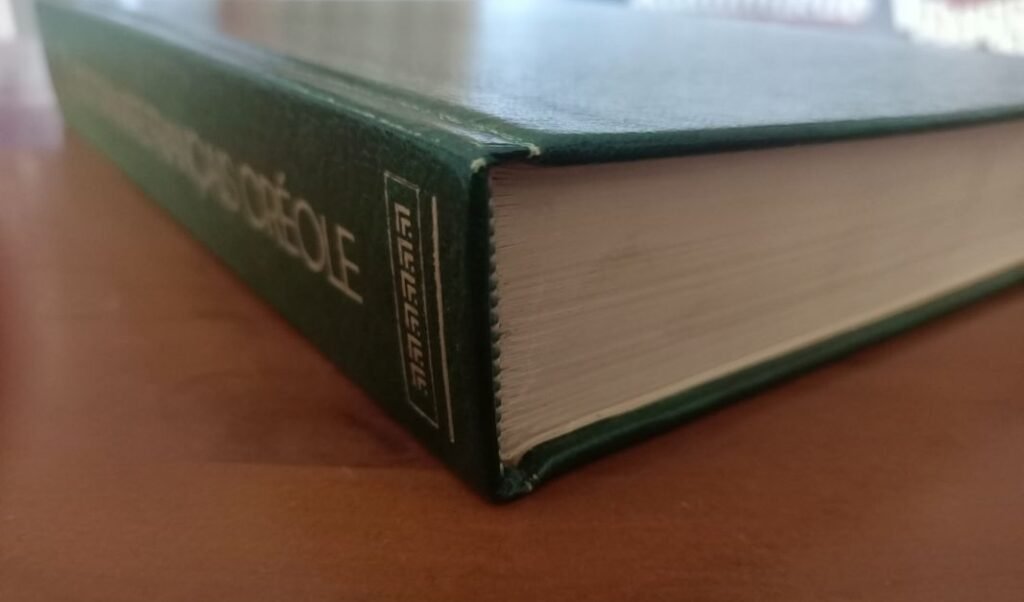
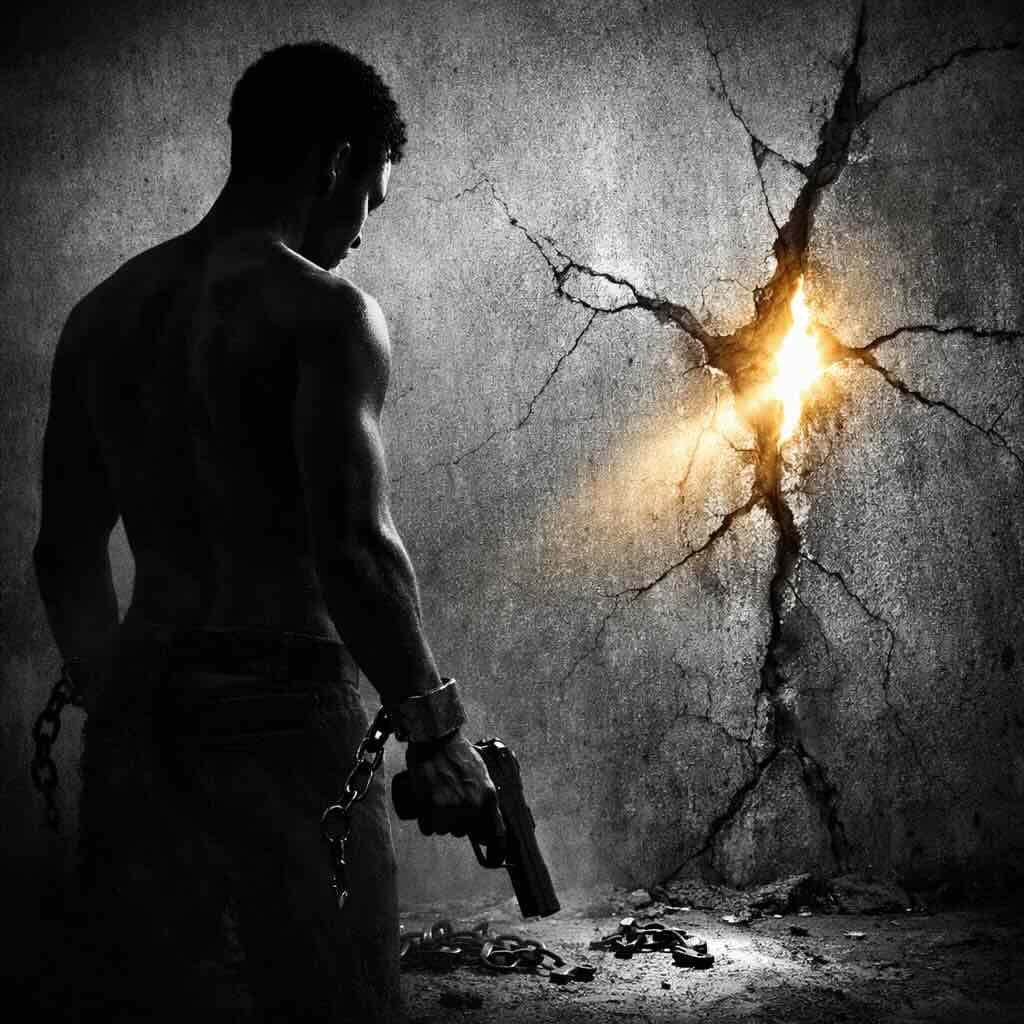










La prévention dans le cadre scolaire et le travil de sensibilisation auprès des parents sont indispensables pour stopper cette escalade de violences sexuelles exercées sur les jeunes. elle permettra une réelle libération de la parole, plus que tout, la peur doit changer de camps. Alors Chers Parents, ensemble protégeons nos enfants, aimons les pour ce qu’ils sont et aidons les à grandir en toute sécurité.