Gwadloup. kabéchaj. Es Kounya-Manman’w sè toujou on gwo jiré ?
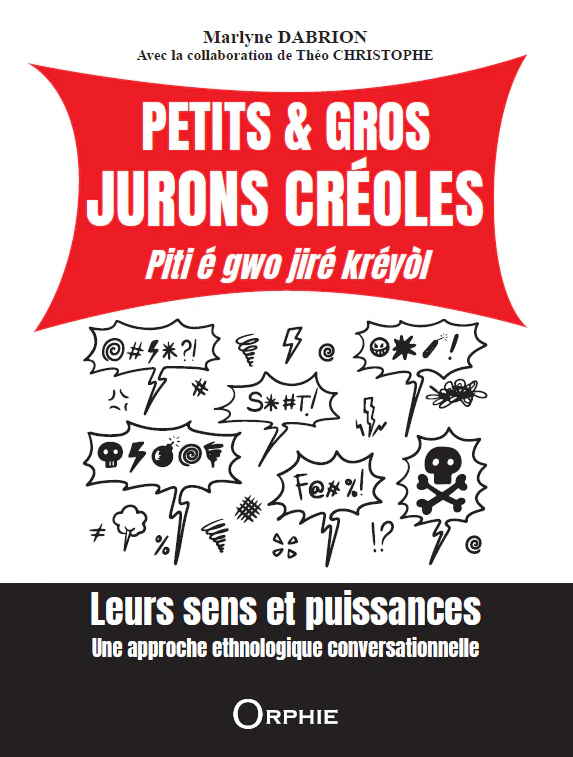
Gwadloup. kabéchaj. Es Kounya-Manman’w sè toujou on gwo jiré ?
Pointe-à-Pitre. Lundi 22 septembre 2025. CCN. Ce mois du “Kreyol” qu’organise depuis des années les services culturels du Conseil Général de Guadeloupe sera marqué par la sortie de 2 ouvrages majeurs. D’abord le Tome 2 du “Woucikam” de Jean Luc Divialle (suite de l’interview dans CCN) et aussi par “Petits et gros jurons créoles” une étude socio-anthropologique faite par Dr Marlyne Dabrion. Sans aucun tabou l’auteure analyse tou sé gro é ti “jiré” qui résonnent au quotidien dans notre quotidien..
Partagez sur
Partagez sur

Save the date Le 23 octobre à Lameca de Basse Terre ; le 24 octobre à la Résidence du Conseil Général au Gosier Marlyne Dabrion donnera 2 conférences; à ne pas rater an plis Fo tout gwadloupéyen li liv la sa !

Save the date Le 23 octobre à Lameca de Basse Terre ; le 24 octobre à la Résidence du Conseil Général au Gosier Marlyne Dabrion donnera 2 conférences; à ne pas rater an plis Fo tout gwadloupéyen li liv la sa !
CCN. Un ouvrage sur les injures en Gwadloup pourquoi ?
Marlyne Dabrion. Depuis assez longtemps, je m’intéresse aux sociétés de la Caraïbe. Ma formation en sociologie et en anthropologie Caraïbe–Amérique latine nourrit cette passion, mais mon premier terrain d’exploration reste la Gwadloup, mon pays. Après Folie douce et fous enragés – une anthropologie créole (2021), j’ai voulu explorer un autre aspect de notre quotidien, à la fois familier et souvent négligé : Piti é gwo jiré kréyòl – Petits et gros jurons créoles : leurs sens et puissances. Car en Gwadloup, nou ka jiré… Mais derrière ces mots qui éclatent se cache une certaine force : celle d’une mémoire collective, d’une créativité langagière et d’une dynamique sociale qui en disent long sur nous-mêmes. Ce livre cherche à révéler cette énergie particulière, là où notre langue, notre culture et notre société s’entrecroisent avec intensité.
Quand on écrit, il y a toujours deux dimensions qui se croisent : une démarche intime, personnelle, et une préoccupation collective. On observe, on vit des situations, on entend et on voit comment les autres agissent. C’est ce mélange qui nourrit la réflexion et, peu à peu, construit la recherche en sciences sociales.
En Gwadloup, tout le monde connaît et peut utiliser les « piti é gwo jiré kréyòl ». Mais derrière cette familiarité apparente se déploie une richesse insoupçonnée : une complexité sémantique et culturelle, façonnée par l’histoire et le vécu collectif, qui éclaire notre identité, nos rapports sociaux et notre manière singulière de vivre ensemble. Alors, ne faudrait-il pas développer davantage les recherches sur cette question ? Replacer les « jiré kréyòl » dans un autre entendement, à l’image de ce qu’ont entrepris les chercheurs français, canadiens et d’ailleurs sur leur propre langue et leur société, permettrait de dépasser le seul prisme de la vulgarité et d’en révéler toute la portée culturelle et sociale.
En réalité, les « jiré kréyòl » ne sont pas seulement des « gros mots ». Ils disent quelque chose de notre culture, de notre histoire et de notre manière de vivre ensemble. Ils expriment une émotion forte, une violence, une vocifération, parfois un humour, mais marquent une position. Ils peuvent parfois , même créer du lien ou désamorcer une tension.
Derrière un «jiré », il y a tout un monde de significations qui mérite qu’on s’y arrête. C’est exactement ce que je cherche à montrer dans ce livre : ces expressions, que beaucoup considèrent comme banales ou vulgaires, portent en réalité du sens, parfois même une véritable puissance. Elles font partie de notre patrimoine immatériel et disent beaucoup sur qui nous sommes en Gwadloup.
J’ajoute aussi une conviction personnelle : nous devons écrire davantage sur notre société. Écrire, c’est partager des réflexions, mais aussi laisser une trace pour les générations à venir. Car dans nos cultures, où l’oralité domine, tant de choses risquent de disparaître si elles ne sont pas transmises par l’écrit.
Et puis, il faut pouvoir parler de ces réalités parfois dissimulées, sans être perçu comme un marginal ou un « extraterrestre ». Mettre des mots sur ce qui reste souvent tu, c’est aussi une manière de mieux comprendre qui nous sommes… et parfois, tout simplement, une façon de dédramatiser.
Ce livre n’est donc ni un recueil de jurons, ni un manuel de vulgarité. La vraie question est de se demander : quels rôles jouent les gros mots en Gwadloup ? Car, dans d’autres sociétés, des chercheurs les étudient depuis longtemps comme un phénomène complexe. Ici aussi, nous pouvons — et devons — les prendre au sérieux.
Évelyne Larguéche (2004) l’a bien résumé : « Pour aborder une anthropologie de l’injure, il est nécessaire d’avoir une connaissance approfondie de la société concernée, de sa culture, de son histoire, de ses normes sociales, ainsi que de ses valeurs. » Cette idée me guide. Avec ma formation et mon regard de Guadeloupéenne, j’essaie simplement de réunir ces deux dimensions. Rien de plus, rien de moins : observer, comprendre et partager une réflexion qui nous concerne tous.
Et si, au fond, les « jiré kréyòl » nous en disaient plus qu’on ne l’imagine sur la Gwadloup d’hier, d’aujourd’hui… et peut-être même de demain ?
CCN. Pendant longtemps s’adresser à une femme en Kréyòl était considéré presque comme une insulte. Ce livre sera comme un apaisement ?
MD. Avant d’aborder cette question, il convient d’en poser une autre : à l’époque de l’économie de plantation, dans quelle langue les hommes réduits en esclavage, puis leurs descendants devenus libres, pouvaient-ils établir une véritable communication entre eux ?
La réponse s’impose : la seule langue réellement partagée par la communauté est alors le kréyòl. Dans ce contexte, lorsqu’un homme s’adresse à une femme dans cette langue, rien ne laisse penser qu’il s’agisse d’une insulte.
Car, même si, à l’origine, il s’agit d’une langue émergente et simplifiée — un pidgin né de la rencontre de populations venues d’Afrique, contraintes de communiquer dans le contexte de l’esclavage et de la colonisation —, il serait faux de dire qu’il était sans repères ni valeurs, même si celles-ci différaient de celles des sociétés européennes.
L’enfant né en esclavage ne grandit pas dans un vide culturel : il hérite, à travers la transmission orale des siens, d’une vision du monde structurée, porteuse de sens et de repères. Ce n’est que bien plus tard, lorsque certains accèdent à la langue du maître et à l’éducation coloniale, que la distinction s’installe. Le kréyòl, langue forgée dans les plantations, reste alors associé à une certaine rudesse, parfois même à un manque d’éducation. Dans ce contexte, pour les nouveaux instruits, parler kréyòl perd progressivement de sa valeur, au point que certains en viennent à le juger « trop ordinaire ».
Peu à peu, cette perception s’ancre dans certains cercles. S’adresser en kréyòl à une femme finit par être perçu comme une marque de familiarité excessive, voire d’irrespect. Ainsi, autour des années 1950-1960, notamment dans la petite bourgeoisie, le français s’impose comme la langue du respect, de la politesse et de la distinction sociale.
Mais ailleurs, dans les milieux populaires, l’histoire est tout autre. L’homme, pas ou peu lettré, continue de s’adresser en kréyòl à la femme, et personne n’y voit une offense. J’en ai moi-même été témoin, enfant : j’entendais alors des échanges polis en kréyòl, marqués par une manière de dire, une attention particulière dans le choix des mots, comme : »
« Mi on bèl bougrès !… Fò an di y bonjou yonn sé jou la » — Voilà une belle créature ! Il va falloir que je lui dise bonjour un de ces jours. Une belle délicatesse transparaît dans ces propos. Plus tard, à l’âge adulte, l’un de mes collègues plus âgés, qui revendiquait fièrement son ancrage paysan, me racontait qu’« à la campagne », les hommes faisaient — bas ayo an kréyòl — leur cour en kréyòl.
Il insistait pour rappeler qu’on pouvait aussi dire des mots d’amour dans cette langue. Une opinion très controversée à l’époque, car elle s’opposait à la vision de la jeune génération montante, qui, au nom de la modernité, prônait le français comme « langue du flirt ».
On pourrait considérer que ce « complexe » — car s’en est un —, qui faisait qu’adresser la parole en kréyòl à une femme relevait de l’impolitesse, s’installe surtout après la guerre, avec l’extension de la scolarisation, le prestige grandissant du français et, par ricochet, la dévalorisation du kréyòl.
J’ai d’ailleurs été témoin d’un autre phénomène, tout aussi révélateur et qui a marqué durablement les esprits. Dans certaines familles populaires, les grands-parents, peu instruits, continuaient naturellement à parler en kréyòl, mais demandaient à leurs enfants ou petits-enfants, ceux qui « ay lékol » — étaient allés à l’école —, de leur répondre en français.
On assistait alors à des scènes surprenantes : le grand-parent posait une question en kréyòl, l’enfant répondait en français. Deux langues, deux mondes, qui se parlaient sans jamais vraiment se confondre.
Ce face-à-face linguistique ne traduisait pas seulement un décalage de langage : il révélait, au cœur même des familles, la tension entre héritage et ascension sociale, entre le kréyòl vécu et le français valorisé.
Aujourd’hui, un autre phénomène se dessine. La roue tourne, et les représentations évoluent. La dichotomie entre les deux langues s’estompe peu à peu, portée par tout un travail pédagogique de valorisation du kréyòl comme langue à part entière.
Dans ce contexte, ce livre peut-il vraiment être perçu comme un apaisement ? Je n’en suis pas certaine, car le « combat » entre les deux langues me paraît désormais dépassé, presque caduc. Aujourd’hui, on passe naturellement d’une langue à l’autre pour communiquer. Les Guadeloupéens sont bilingues, oui… mais en matière d’injures, ils restent monolingues : « An Gwadloup, nou ka jiré an kréyòl ! » — En Gwadloup , nous jurons en créole. Rares sont ceux qui jurent en français.
Et c’est précisément ce qui me paraît essentiel à mettre en lumière dans notre vécu culturel. Pourquoi, spontanément, allons-nous puiser dans « zépons natirèl an nou » — nos éperons naturels — pour jurer ?
Ce réflexe montre à quel point l’injure en kréyòl s’ancre non seulement dans l’histoire, les valeurs et les représentations collectives, mais aussi dans la profondeur psychique de chacun. Autrement dit, elle n’a rien d’anodin : elle révèle la force d’un rapport culturel au langage, où le kréyòl demeure le lieu privilégié de l’expression brute des émotions.
Avec ce livre, je ne cherche ni à banaliser l’injure, ni à la glorifier. Mon but est simple : comprendre. Que disent vraiment les « jiré kréyòl » ? Quels codes suivent-ils ? Quelles émotions traduisent-ils ? Comment évoluent-ils ou se transforment-ils ?
Derrière ces mots, il y a une culture, une histoire. Des manières d’exprimer la colère, la rage, la violence ou la douleur. Mais aussi l’humour et la complicité.
Au fond, peut-on concevoir cela comme une force ? une faiblesse ? une manière de se reconnaître soi-même ? En tout cas essayer d’expliquer, cette complexité, c’est déjà désamorcer. Écrire, c’est ouvrir un autre regard, démystifier… et libérer la parole.
CCN Après avoir fait l’inventaire des « gwo e ti jiré » le mo a manman est-ce toujours le juron le plus violent ?
MD. Est-ce vraiment un inventaire ? Si certains le perçoivent ainsi, je l’accepte, mais je n’avais pas cette prétention. Mon objectif était plutôt qualitatif que quantitatif, car il existe certainement d’autres jiré que je ne connais pas, ou que je n’ai pas perçus…
Il est vrai cependant que le “mo a manman” occupe une place à part. Dans l’imaginaire collectif, il demeure perçu comme l’un des jurons les plus violents, parce qu’il touche à ce qu’il y a de plus sacré :
- La figure maternelle. J’ai d’ailleurs illustré, dans le livre, cette question par des faits culturels patents, mettant en scène des personnes respectables ayant publiquement prononcé ce gwo jiré. Dans une société où le respect de la mère constitue un pilier, y porter atteinte par la parole revient à transgresser un interdit fondamental.
Mais il faut nuancer : la violence d’un « jiré kréyòl » ne dépend pas seulement du mot employé. Elle réside aussi dans le ton, le contexte et l’intention.
Le même mot peut être perçu comme une simple provocation dans un cercle familier, ou comme une offense grave dans une autre situation.
Prenons l’exemple du Tchip ! : cette onomatopée très populaire est un simple son produit avec la langue et les lèvres dans un mouvement précis de succion. Elle appartient au registre de l’oralité, mais constitue un interdit formel envers ses parents. Elle n’a pas de signification propre… et pourtant, elle peut tout dire. Sacrilège ! On ne Tchip ! pas sa mère ni son père !
L’analyse des « jiré kréyòl » montre bien que chaque insulte transporte plus qu’un mot : elle véhicule des représentations, des émotions, une mémoire parfois traumatique. Le “mo a manman” en est une illustration forte, mais il n’est pas le seul à porter cette charge symbolique.
On peut être marqué à vie par certains interdits propres à sa génération. Ainsi, pour beaucoup d’entre nous, le “mo a manman” appartient à un cortège d’inimaginables, d’imprononçables, de prohibés à tout jamais.
À la limite, on peut l’écrire… mais le prononcer, non !
Parfois, il reste possible de le dire « dans sa tête » !.. Quand cela s’impose vraiment. C’est une manière détournée d’échapper au discrédit attaché à sa prononciation, tout en participant malgré tout à sa violence, mais de façon silencieuse. Un compromis fragile avec soi-même.
Cette ambiguïté résume bien la force des « jiré kréyòl » : à la fois interdits et nécessaires, violents et libérateurs, ils traduisent le poids, mais aussi les failles, d’une culture dans une société en mutation. Aujourd’hui, on observe un certain changement chez les jeunes générations. Le fameux “mo a manman”, d’usage restreint mais grave, autrefois, pesait comme un coup de poignard symbolique. Il est désormais employé beaucoup plus fréquemment. On l’entend partout, dans la rue, parfois même sur un ton de plaisanterie. Le poids moral qui l’accompagnait s’est-il estompé, jusqu’à banaliser son usage ?
Alors qu’un simple « mauvais regard » suffit désormais à déclencher une tension immédiate. Ce qui n’était hier qu’un détail insignifiant peut aujourd’hui dégénérer en affrontement. Là où la parole insultante semble se socialiser, le regard, lui, est devenu une arme redoutée.
Alors, s’agit-il d’un déplacement des priorités, d’une volonté délibérée de se démarquer des « vieux » et de leur système de valeurs ? Ou bien assistons-nous à un glissement de l’injure vers le regard, qui s’impose avec intensité ?
Un tel décalage nous invite à réfléchir : derrière les mots comme derrière les gestes, il y a toujours des interdits et leur franchissement, des émotions exacerbées et toute une stratégie relationnelle qui se redéfinit dans les contextes actuels.
CCN. Aux USA, le juron sans doute le plus utilisé est fuck, fucking ou mother fucking sont-ils aussi « durs » que notre mot de manman ?
MD. Nous avons bien circonscrit notre travail au « jiré kréyòl » et spécifiquement à ceux de Gwadloup. Mais nous savons pertinemment que certains de ces jiré franchissent allègrement les frontières territoriales.
C’est pourquoi Théo Christophe a rédigé le chapitre 5 du livre, intitulé « Jiré koté nou » — Injures chez nos voisins. Connaisseur des usages dans certains territoires proches, notamment la Dominique, il s’est intéressé aux pratiques langagières de ce pays.
Il nous explique : « Les Dominiquais sont bilingues, créolophones et anglophones. S’ils connaissent les «jiré kréyòl»utilisés dans les îles voisines, ils préfèrent toutefois recourir à l’anglais pour injurier. » Dans ce contexte, des expressions comme fuck, fucking ou motherfucker circulent largement en Dominique. Leur fonction varie : fuck peut servir d’insulte directe (« va te faire foutre »), fucking agit comme un intensificateur (« fucking stupid », équivalent de « foutu » ou « satané »), tandis que motherfucker (« fils de pute ») reste une injure forte, adressée à une personne méprisée. Mais contrairement au “mo a manman” en Gwadloup — qui demeure un interdit absolu, chargé d’une valeur sacrée liée à la mère — motherfucker en Dominique n’aurait pas, actuellement cette puissance symbolique. Il choque, certes, mais il semble plus banalisé, influencé par son usage courant dans la culture anglophone et américaine.
Pour ma part je n’oublie pas ce qu’une vieille Dominicaise m’avait dit, alors que j’étais une jeune adolescente de 18 ans, lorsque je lui avais demandé la signification de cette expression : « Pa jen répété sa, ti moun, sé on mo sal — Ne répète jamais cela, mon enfant, c’est un mot sale. ». À voir son visage profondément marqué par ma question, je comprenais que j’avais touché à un tabou.
Cette évocation révèle que la force d’un juron ne réside pas tant dans les mots eux-mêmes que dans le contexte culturel qui les façonne, et dans la temporalité qui en détermine la portée. On peut envisager qu’un glissement comparable à celui du “mo a manman” en Gwadloup se produise, chez les jeunes de Dominique, avec l’usage du motherfucker. Cependant, la prudence s’impose : nous connaissons trop peu ce pays pour avancer des conclusions hâtives. En effet, « aborder une anthropologie de l’injure suppose une connaissance approfondie de la société concernée, de sa culture, de son histoire, de ses normes sociales et de ses valeurs ».
Si nous pouvons analyser nos propres jiré avec une certaine assurance, il n’en va pas de même pour ceux de nos voisins, d’autant plus qu’aucune étude publiée ne documente encore cette question. Restons donc circonspects dans nos propos à leur sujet.
En Gwadloup, on observe toutefois un phénomène croissant chez certains jeunes imprégnés de la culture dominiquaise. Les échanges musicaux et les univers artistiques favorisent l’adoption, par imitation, de jurons à sonorité anglaise — employés davantage comme signes de style que dans une réelle intention d’injurier. Cette tendance interroge sur l’attrait que peuvent exercer certaines pratiques culturelles venues d’ailleurs.

Abonnez vous à la Newsletter CCN pour ne rien manquer !


Abonnez vous à la Newsletter CCN pour ne rien manquer !

CCN. Les injures guadeloupéennes sont-elles, à votre avis, très violentes au point de déclencher un goumé ?
MD. Par essence, toute injure constitue déjà une forme de violence verbale. Prenons l’exemple du “mach…!”, cette interjection énergique utilisée pour interpeller un chien. Lorsqu’elle est adressée à un être humain, elle devient hyper violente : elle dégrade, elle animalise. La personne visée peut alors réagir vivement, en s’indignant : « An sé on chien, alo pou’w di mwen mach ? » — Je suis donc un chien, pour que tu me dises mach ? C’est précisément ce glissement — de la parole vers l’atteinte à la dignité — qui peut déclencher un “goumè”. Dans notre culture, l’honneur est un bien précieux : quand il est bafoué, la riposte apparaît presque immédiate, comme inévitable.
Bien entendu, tout dépend du contexte, du moment et des personnes présentes. L’injure en kréyòl n’est jamais neutre : elle vise l’honneur, la réputation, parfois ce qu’il y a de plus intime. Il suffit d’un mot mal placé, d’une allusion à la mère, à la lignée ou à la dignité, pour que la joute verbale bascule dans l’affrontement physique. Dans mon enfance, j’ai souvent vu des disputes de voisinage s’enflammer ainsi : en un instant, les mots cédaient la place aux coups, parce que le seuil de l’inacceptable avait été franchi.
Certaines injures guadeloupéennes portent donc en elles une charge si violente qu’elles peuvent suffire à déclencher un “goumè”. Mais ce n’est pas une règle absolue : la réaction à l’offense n’est jamais prévisible. L’injurié peut aussi choisir de ne pas donner prise, en s’abritant derrière l’adage bien connu : « Pawol sé van » — « La parole, c’est du vent » —, pour refuser de répondre à la violence verbale par la violence physique.
En réalité, pour qu’un « jiré » soit perçu comme véritablement violent, il faut un double regard : celui de l’injurieur, qui l’énonce avec l’intention de blesser, et celui de l’injurié, qui le reçoit comme tel. Autrement dit, un « jiré » ne devient violent que si l’interaction entre les deux lui confère ce caractère. S’il existe un décalage — si l’un n’accorde pas la même valeur que l’autre à l’injure — l’effet tombe à plat, sans violence réelle, sans “goumé ”. En matière de « jiré », tout est donc relatif.
Enfin, le « jiré » n’entraîne pas toujours un passage à l’acte. Lorsqu’il ne débouche pas sur un affrontement, l’injure sert aussi de soupape : elle permet à l’injurieur d’expulser sa colère, de se défouler verbalement, et parfois d’éviter que la tension ne s’exprime autrement. Mais la frontière entre l’injure et le coup reste mince, dépendant largement du tempérament et du contexte. En ce sens, les injures guadeloupéennes portent bien une puissance capable de déclencher un “goumé”.
Mais, paradoxalement, elles jouent aussi un rôle de régulation sociale, en permettant de dire l’indicible sans nécessairement en venir aux mains.
CCN. Le mot bonda, d’origine africaine (bounda), est-il considéré comme insultant ?
MD. En observant le milieu guadeloupéen, on constate que le mot, aussi révélateur soit-il, ne suffit pas, à lui seul, à constituer une insulte. Et cela, quelle que soit son origine — qu’elle soit géographique, historique ou même politique. Si l’étymologie a son importance d’un point de vue linguistique, c’est surtout la dynamique d’usage en contexte qui détermine, sur le plan social et anthropologique, s’il s’agit ou non d’une injure.
Rappelons qu’en kréyòl de Gwadloup, le terme « jiré » peut signifier juron, injure ou insulte. Ce sont donc les natifs qui sont les mieux placés pour préciser ce distinguo lorsqu’on le traduit en français. Le mot “bonda”. Désigne d’abord, de manière familière, les fesses. Employé par un groupe d’hommes parlant d’une femme — par exemple : « fanm la sa ni on kalité bonda !» (Cette femme a des fesses imposantes) —, il s’agit alors d’une appréciation, sans volonté de nuire ni d’offenser. Dans ce cas, le mot relève d’un registre familier et renvoie à son origine africaine (bonda / nbunda), associée au postérieur.
Toutefois, dans certaines situations, notamment lorsqu’il est utilisé entre hommes, le terme peut prendre une connotation grivoise, avec un sous-entendu érotique, comme c’est parfois le cas en kréyòl guadeloupéen.
Même dans son acception familière, ce mot reste proscrit du vocabulaire des enfants par leurs parents, ainsi que des échanges polis entre adultes. En revanche, il peut être employé par ces derniers pour exprimer une colère ou un agacement. Il fonctionne alors comme un juron, par exemple lorsqu’une mère s’adresse à son enfant connu pour aimer « dwivé » vagabonder : « foutez bonda aw isidan timoun, ou tann sa an di’w ?! » — Pose tes fesses ici, garçon, as-tu entendu ce que je te dis ?!”.
Chez nos voisins haïtiens, on emploie plutôt “bouda” à l’oral. Le terme y est souvent utilisé dans la conversation courante et demeure neutre en soi. Mais, comme pour « cul » en français, son caractère injurieux dépend du ton, du contexte et de l’intention.
Exemple d’usage injurieux : lorsqu’il est lancé directement à quelqu’un avec l’intention de le rabaisser, comme dans : « Gade bouda ou, al chita ! », que l’on peut traduire par : Espèce d’imbécile, va t’asseoir !..
Enfin, en Gwadloup, la plupart des « jiré » kréyòl, y compris “bonda”, peuvent également être utilisés sur le mode humoristique : par moquerie au sein d’un groupe de femmes, ou par grivoiserie entre hommes, dans des cercles de sociabilité restreints.
CCN. On remarque que les pires insultes s’adressent à la femme. Comment expliquer ça ?
MD. Les recherches en anthropo-linguistique montrent que, dans de nombreuses sociétés, les insultes les plus violentes s’adressent aux femmes (Miller, 1987). Loin d’être neutres, elles révèlent la manière dont les rapports sociaux de sexe sont structurés. Là où les hommes sont parfois attaqués sur leur virilité, leur courage ou leur force, les femmes sont, elles, beaucoup plus systématiquement visées à travers leur sexualité, leur fidélité ou leur respectabilité. L’injure devient alors un outil de hiérarchisation et de disqualification symbolique, traduisant une asymétrie persistante entre les genres.
En France, société patriarcale, les insultes adressées aux hommes touchent surtout à leur puissance sexuelle (« impuissant », « pédé », « couille molle ») ou à leur courage (« lâche », « minus »). À l’inverse, celles visant les femmes — « pute », « traînée », « garce » — sont plus nombreuses et attaquent directement leur réputation et leur moralité (Haut Conseil à l’Égalité, 2018).
En Gwadloup, les hommes sont moins directement visés ; lorsqu’ils le sont, c’est le plus souvent pour leur dénier la virilité (« boklè ») ou les rabaisser en les rapprochant symboliquement du féminin (« makanda », « makonmè »). Le déséquilibre est patent : les « jiré » kréyòl les plus marquants ciblent la femme, qu’ils attaquent dans son rôle maternel, sa moralité ou sa décence (« rat », « salop », « fanm cho », « koch », « golomin-n »).
Cette asymétrie trouve une partie de son origine dans l’histoire coloniale et esclavagiste, où le corps féminin — particulièrement celui des femmes noires — a été hypersexualisé et instrumentalisé. Paradoxalement, dans une société guadeloupéenne de type matrifocale, le langage conserve à la fois ces traces de domination passée et des accents de vénération de la femme poto mitan, à travers des expressions comme « manman sé tout » (la maman, c’est tout). Cela confère à l’injure une charge symbolique qui dépasse la simple parole et perpétue une mémoire culturelle fracturée.
Mais les jeunes générations acceptent-elles encore cette focalisation ? Non. Car, de plus en plus, des femmes s’affirment comme de véritables — « fanm doubout » — (femmes debout), refusant toute stigmatisation verbale. Certaines n’hésitent plus à répliquer : — « nou pa pè lang a nonm » — (nous ne craignons plus la langue des hommes) , allant même jusqu’à retourner les armes de la parole en maniant les pires « jiré kréyòl », au point de désarçonner leurs adversaires.
Ce phénomène accompagne une mutation profonde de la société guadeloupéenne. La montée en puissance des femmes est manifeste, qu’il s’agisse de politique, de commerce, d’art ou d’autres domaines de la vie publique. Plus qu’un simple éclat de langage, l’injure révèle aujourd’hui une lutte souterraine qui redessine les rapports hommes-femmes en Gwadloup.
CCN. Après votre étude, que peut-on dire sociologiquement des jiré Gwadloup ? On a l’impression que ceux d’Haïti ou de Martinique sont moins « durs » ?
MD. Sociologiquement, on peut dire qu’en Gwadloup, les « Piti é gwo jiré kréyòl » — jurons, injures et insultes en créole — jalonnent le quotidien. Ils éclatent dans la rue, résonnent dans les transports, s’immiscent dans les familles, mais se glissent aussi dans les établissements scolaires ou professionnels. Bruyants, parfois crus, ils apparaissent d’abord comme une entorse aux normes éducatives : une marque d’impolitesse, de tension ou même d’agressivité. Pourtant, sous cette rudesse apparente, ils sont souvent tolérés, car ils obéissent à des repères tacites, profondément ancrés dans la culture guadeloupéenne.
D’où le paradoxe : —Pourquoi ce qui heurte les convenances continue-t-il de circuler avec une telle fréquence ? Que cherche-t-on à exprimer à travers un « ti jiré » ou un « gwo jiré » ? Que se joue-t-il dans ces mots qui blessent, bousculent, mais libèrent aussi — parfois comme un soupir ?
C’est ce paradoxe qui a guidé ma recherche sur les « Piti é gwo jiré kréyòl » en Gwadloup. Nous avons élargi le regard vers d’autres terres créoles, là où la pratique du jiré prend d’autres formes : en Martinique, en Haïti, à la Dominique. Car ces voix venues d’ailleurs résonnent aussi chez nous, comme le montre Théo Christophe dans “Jiré koté nou” — Injures chez nos voisins.
Vous me dites avoir l’impression qu’elles sont “moins dures” que celles de Gwadloup. L’impression est légitime, mais elle reste subjective : chacun la ressent différemment, et seule une étude comparative rigoureuse permettrait de trancher. Pour ma part, je ne partage pas ce sentiment : les jiré d’Haïti ou de la Dominique comptent parmi les plus virulents que j’aie entendus.
Ce que montre notre étude, et que je rappelle ici en substance, dépasse la simple invective. Le « jiré kréyòl » est une parole sociale, un langage chargé d’émotion, un outil de régulation relationnelle, une manière de rétablir un équilibre symbolique. On le rencontre dans la sphère familiale, dans le voisinage, dans le monde du travail. Il peut s’entremêler à la violence ordinaire, mais il éclaire aussi la façon dont une société exprime ses tensions.
À l’échelle individuelle, le jiré peut révéler une souffrance qui ne trouve pas d’autres mots. Il agit comme une catharsis : il soulage, il libère. Dans une société où la parole sur la santé mentale reste encore largement contenue, il joue un rôle de soupape au cœur d’une culture dominée par l’oralité.
Ainsi, l’injurieur et l’injurié ne sont pas de simples adversaires dans une confrontation binaire. Ils participent à un processus relationnel plus complexe, nourri d’émotions, de codes implicites et de traditions partagées.
Explorer les « Piti é gwo jiré kréyòl », c’est donc aller au-delà du bruit des mots. C’est interroger les formes discrètes de la violence sociale, sonder les non-dits du lien communautaire et, finalement, mieux comprendre ce qui tisse les liens culturels en Gwadloup.
CCN. Faire l’amour avec une femme », en français, est une expression que l’on considère comme convenable. Peut-on dire que koké on fanm soit du même registre en Gwadloup? Koké serait-il une insulte ? (Cf. ay koké manman’w)
MD. Ça, c’est un gros morceau ! Mais je ne vais pas fuir, je vais vous répondre…
La question est délicate et passionnante. Elle touche à une zone frontière entre « jiré » et sexualisation en Gwadloup : deux univers proches, mais qui ne se confondent pas. On peut très bien injurier sans recourir au vocabulaire du sexe. La preuve nous vient du Québec, où les jurons appelés « sacres » — parce qu’ils relèvent du registre religieux — mobilisent des mots comme “Tabernacle !”, “Hostie !”, “Ciboire !”, “Calice !”, “Calvaire !”, “Crucifix !”, “Sacrement !”, etc. Leur caractère violent ne fait aucun doute, même s’ils ne relèvent pas de la sexualité.
Toutefois, les sacres sont utilisés comme interjections pour exprimer une palette d’émotions très variée comme la colère, la frustration, la surprise, la douleur, l’exaspération, la peur, l’impuissance, la stupéfaction, etc. Selon Valérie Bässler, « leur fonction principale serait donc la décharge émotive », puisqu’ils servent d’interjections pour exprimer la colère, la frustration, la surprise, la peur ou encore l’impuissance.
Concernant l’expression “faire l’amour” que vous évoquez, elle relève d’un registre euphémisé : l’expression adoucit la réalité en mettant en avant la tendresse, l’intimité et la complicité. En Gwadloup, le kréyòl dispose également de formules policées et imagées — « rété », « kouché ansam», « dòmi èvè on moun », « fè lanmou » — qui permettent de dire l’acte intime sans heurter. On les retrouve surtout chez les adultes créolophones, même si d’autres estiment ce vocabulaire un peu vieilli. Ceux qui utilisent l’expression “ koké on fanm ” — baiser une femme — changent sciemment de registre. Le verbe est cru, direct, sans détour. Il décrit l’acte sexuel dans sa matérialité brute, là où le français classique préfère l’atténuation.
Et dans l’injure, un cap est franchi. “Ay koké manman’w” — va baiser ta mère —, probablement emprunté à l’usage dominiquais et popularisé par la jeune génération, devient une formule de transgression extrême : sexualité, inceste et atteinte à la mère — figure sacrée en Gwadloup — se mêlent dans cette déflagration verbale. Ce n’est plus de la simple vulgarité : c’est une arme symbolique redoutable, qui agit comme une sorte de “viol mental”, en forçant l’accès à l’intimité la plus inviolable de l’autre.
Au quotidien, le verbe « koké » peut simplement désigner un rapport charnel. Mais, dans le « jiré kréyòl », il se charge d’une violence symbolique majeure. Ce niveau de transgression extrême n’était pas, à l’origine, une habitude guadeloupéenne, même si le terme lui-même appartient au vocabulaire sexuel. Son expansion traduit le franchissement progressif de barrières générationnelles. Je me souviens de mes années de collège : certains garçons, jugés hardis ou dévergondés, inscrivaient ce mot à la craie sur le passage des filles, notamment près des toilettes, pour les choquer. Ils utilisaient alors la graphie française — avec un “C” —, car l’écriture kréyòl n’avait pas encore émergé.
Aujourd’hui, une partie de la jeunesse en Gwadloup revendique le droit de nommer sans détour les mots les plus crus du sexe, en kréyòl « non-trafiqué ». On les entend dans la rue, mais aussi dans certains refrains de carnaval, notamment au sein de groupes comme VIM, qui assument un langage provocateur longtemps prohibé par leurs aînés.
Comme je l’ai dit au début de ma réponse : “Ça, c’est un gros morceau !”. Peut-être suis-je perçue comme démodée, mais je ne peux pas adhérer totalement à ce « vay », et mes propos pourraient susciter des controverses.
Ce travail sur les « Piti é gwo jiré kréyòl » — jurons, injures et insultes — ne se limite pas au seul prisme de la sexualisation, même si cette dimension y croise parfois son chemin. Il mobilise la sociologie, l’anthropologie, la psychologie et la linguistique pour considérer le «jiré kréyòl » comme un acte social et culturel porteur de sens : expression émotionnelle, régulation relationnelle, rééquilibrage symbolique, et parfois même catharsis.
Dans cette dynamique, l’« injurié » et l’« injurieur » participent à un processus relationnel complexe qui met en lumière, souvent à leur insu, les mécanismes cachés des relations sociales en Gwadloup, parfois tourmentées.
CCN. Une lesbienne se dit « on fanm ka fè zanmi ». Est-ce aussi insultant que « Misyé sé on makonmè » ?
MD. L’expression “on fanm ka fè zanmi “ Comme vous dites, illustre bien une réalité sensible concernant la femme en Gwadloup. Mais, pour mieux répondre, je préfère reformuler. On pourrait dire : « on fanm a zanmi » face à « Misyé sé on makonmè ». Dans ce cas, les deux expressions touchent directement à l’identité sexuelle.
Il existe pourtant une nuance importante. En dehors de leur orientation ou de leur genre, certaines personnes peuvent avoir ponctuellement des rapports avec des partenaires du même sexe. En Gwadloup, comme ailleurs, cela existe sans qu’elles se revendiquent pour autant comme «makonmè » ou « fanm a zanmi ». Le kréyòl fait bien la différence : « fè zanmi » ou « fè makonmè »
Pour parler de l’acte, sans forcément coller une étiquette définitive. Et tout le monde comprend ce que cela signifie quand, dans la rue, on entend « entèl ka fè makonmè » : on parle d’un comportement, pas d’une identité.
C’est là que réside la vraie différence. L’étiquette (« fanm a zanmi », « makonmè ») enferme et stigmatise, tandis que la référence à l’acte reste ponctuelle. En kréyòl, être réduit à « sé on makonmè» ou « sé on fanm a zanmi », c’est comme recevoir un tampon sur le front : une condamnation sans appel.
Le genre rend la chose encore plus lourde. Pour une femme, être traitée de « fanm a zanmi» ne touche pas seulement à sa sexualité : c’est sa respectabilité sociale et familiale qui est en jeu. On sait
Bien que, dans les quartiers, une telle parole peut suffire à ternir une réputation. Mais il fut un temps où ces situations étaient très rares. Et lorsqu’on savait, on n’en parlait pas ouvertement : c’était une manière, malgré la désapprobation contenue, de respecter ces personnes dans leur choix. Elles n’étaient pas attaquées de front par l’injure, même si leur zone de fréquentation restait très limitée à cause de la méfiance des autres.
Pour un homme, « makonmè » est l’une des pires insultes, parce qu’elle attaque directement sa virilité. C’est une manière de dire : « ou pa on nonm », tu n’es pas un homme. Derrière ces mots, il y a donc beaucoup plus qu’une simple insulte. Le « jiré kréyòl » exprime la façon dont la société guadeloupéenne classe, juge et hiérarchise les comportements. Et cet héritage vient de loin : depuis la société de plantation, la virilité de l’homme noir a été rabaissée, ridiculisée, tandis que la respectabilité de la femme noire a été constamment mise en doute. Ces blessures traversent encore nos paroles. Quand on traite quelqu’un de «makonmè», on ne fait pas qu’insulter : on réactive des mémoires et des rapports de pouvoir anciens.
Voilà pourquoi le « jiré kréyòl » n’est pas seulement du « langage vulgaire » ou une provocation de carnaval. Il est un miroir grossissant de notre histoire, de nos tensions, de nos façons de juger. Et il est aussi, paradoxalement, un espace où la société dit tout haut ce qu’elle tait d’ordinaire.
Pour terminer, je vous dirai qu’il y aurait encore tant à dire sur cette question, qui ne saurait se réduire à une simple interview. Alors, puissions-nous, lors d’autres rencontres, enrichir encore cet échange… Merci !
Références bibliographiques
▪ Miller, B. A. (1987). Sexist insults: A cross-cultural analysis. Sex Roles, 16(5–6), 207–224. ▪ Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE). (2018). État des lieux du sexisme en France. Paris : Haut Conseil à l’Égalité.
▪ Dabrion M. avec une collaboration de Christophe T. (2025). Petits et gros jurons créoles » -Piti é gwo jiré kréyòl -, leurs sens et puissances– Une approche ethnologique conversationnelle , éditions Orphie, France.
Marlyne DABRION Ph.D
Docteur de l’Université, René DESCARTES PARIS V
Sciences Sociales. Spécialité : Sociologie
Cadre supérieur de santé de la foncHon publique hospitalière
Ancienne Directrice–Adjointe d’IFSI
dabrion.marlyne@gmail.com
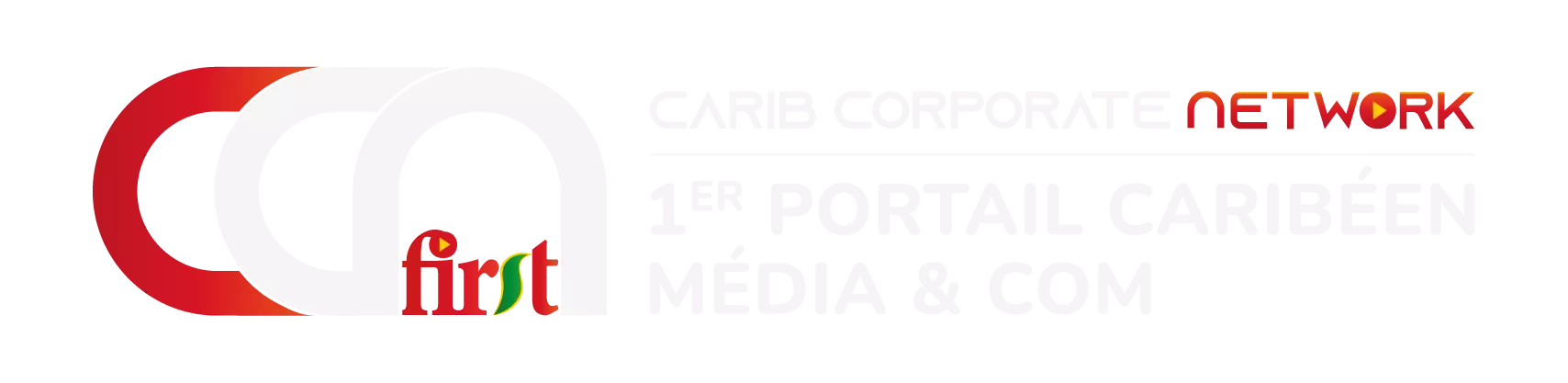














C’est un excellent travail.
J’ai beaucoup appris de cet interview.
Très belle interview.
Excellente réflexion sur la meilleure compréhension d’une culture à travers l’étude du sens profond des jurons.
Chapo ba pou ou ! Ou fè on bèl travay liv à wou a, en fyè dès w- ou. Ou montré kè lang kréyòl la sé an richès ki ka kontinyé viv. Kontinyé ékri, kontinyé fè kilti an nou briyé. On dot fwa, gran bravo pou ou !
Félicitations pour ton livre et ton interview ! Je suis fiere de toi. Tu as réussi à donner vie à la richesse du créole à travers ton écriture, et c’est une belle contribution à notre culture et à notre identité. Bravo pour ton courage, ta créativité et ton travail. Continue à faire briller notre langue et notre patrimoine.
Très belle interview 👍🏽
Excellente réflexion sur la meilleure compréhension d’une culture à travers l’étude du sens profond des jurons.
Cet ouvrage montre les particularismes de la Société Guadeloupeene,d’un point de vue
culturel et historique y compris face à l’influence de la culture angloxaxone Caribéenne.
En effet, une approche originale pour comprendre les spécificités et la complexité de la Société Guadeloupeenne dans un monde en pleine mutation.