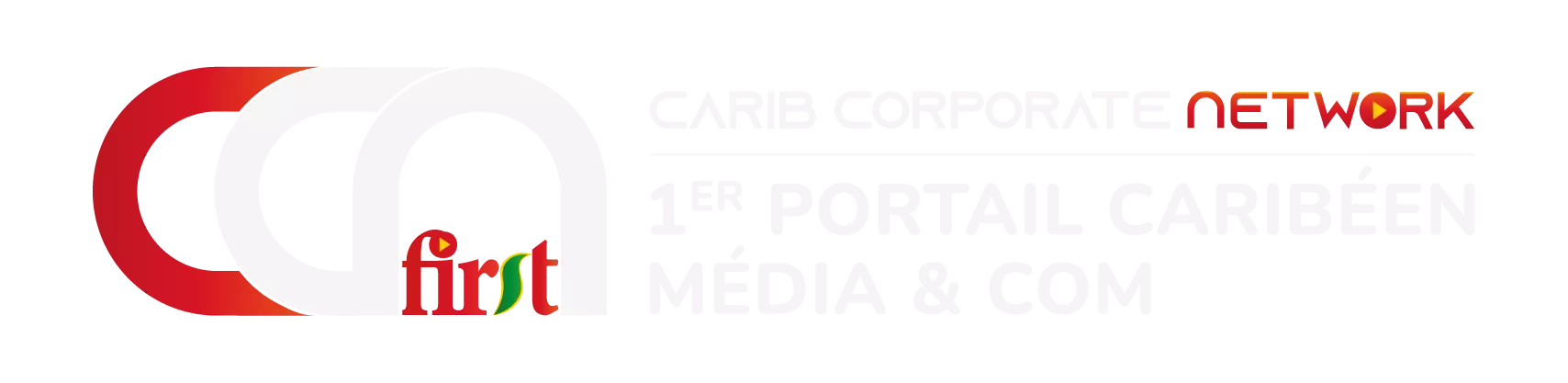Guadeloupe. Société. J’apprends, je crée, j’existe : la jeunesse guadeloupéenne face au défi de la violence

Guadeloupe. Société. J’apprends, je crée, j’existe : la jeunesse guadeloupéenne face au défi de la violence
Pointe-à-pitre. 9 octobre 2025. Pawol Lib – Comme le sociologue guadeloupéen Ary Broussillon le soulignait : la violence qui traverse notre jeunesse n’est pas un simple dérapage individuel, mais le résultat d’un système éducatif et social en décalage avec la réalité culturelle des jeunes de Guadeloupe. L’école, loin de compenser les inégalités, devient trop souvent un lieu d’infériorisation. Ceux qui n’ont pas les “bons codes” se sentent rejetés, incompris, humiliés. La rue, elle, leur offre une autre forme de reconnaissance, brutale mais immédiate, où la force, la transgression et le “buzz” remplacent la réussite scolaire. Pour beaucoup, le choix est cruel : « je mords ou je meurs ».
By Laïla CASSUBIE
Partagez sur
Partagez sur
Quels espaces pour ces jeunes ?
Espaces d’accueil neutres et attractifs
- Des lieux ouverts dans les quartiers, accessibles sans
- Wifi, musique, consoles, ateliers libres : un cadre où les jeunes viennent d’abord “chiller”, avant de s’ouvrir à d’autres propositions.
- Encadrés par des éducateurs de rue et des pairs respectés dans le
Espaces de formation par l’action
- Ateliers pratiques reliés à leurs centres d’intérêt : rap, vidéo, sport urbain, graphisme, mécanique, cuisine, agriculture
- Méthode : “apprendre en faisant”, avec résultats visibles
- Possibilité de petites gratifications (stages rémunérés, mini-bourses).
Nous avions créé ce type d’espace avec l’association Contact Rue – Cyber Gwada à Vieux Bourg Abymes autour de l’informatique, les jeux informatiques et un studio d’enregistrement et animés par des jeunes qui connaissaient ou avaient déjà connu les codes de la rue.
Espaces économiques alternatifs
- Chantiers-écoles rémunérés : rénovation en particulier, agriculture bio, énergies
- Incubateurs de micro-projets pour financer leurs propres
Pourquoi pas la construction ou la rénovation pour leur propre espace dans le quartier
Espaces d’expression et de reconnaissance symbolique
- Studios de musique et de podcast, scènes ouvertes, murs de graff autorisés.
- Concours et événements réguliers (slam, danse, vidéos TikTok créatives).
- Valorisation publique : transformer le prestige de la rue en prestige créatif.
Espaces de médiation et d’accompagnement
- Permanences avec médiateurs, éducateurs, psychologues de rue et groupes de paroles sur la violence, les émotions, la construction identitaire
- Aide pour les démarches administratives, formation,
Cet espace peut être intégré à leur propre lieu qu’ils auraient rénové et construits.
Espaces hybrides sport + culture + insertion
- Terrains de sport ouverts le soir (foot, basket, boxe) couplés à des ateliers de parole ou de création.
- Organisation de tournois et d’événements qui redonnent visibilité et fierté.
- Bus ou structures mobiles (“street campus”) qui se déplacent dans les
Street campus, bus ou structures mobiles qui se déplacent dans les quartiers, espace mobile et polyvalent pour aller à la rencontre des jeunes dans leurs quartiers, plutôt que d’attendre qu’ils viennent dans des structures classiques (souvent perçues comme trop institutionnelles).
À l’intérieur (ou autour quand il s’installe) on trouve :
- Un mini-studio de musique / podcast pour rapper, slamer,
- Un coin numérique avec ordinateurs, wifi, montage vidéo,
- Un espace créatif pour graff, peinture, customisation de sneakers, t-
- Un terrain modulable (paniers mobiles, matériel de sport de rue).
- Un espace de parole animé par des éducateurs et des pairs du
Les éducateurs de rue mais aussi des professionnels, au cœur du dispositif
La réussite de tels espaces repose avant tout sur les personnes qui les animent. Il ne s’agit pas seulement d’y placer des professionnels formés, mais de bâtir une équipe qui inspire confiance et respect. Pour toucher des jeunes déjà gagnés par la rue, la crédibilité est essentielle. Cela suppose de recruter des figures locales reconnues, des “grands frères” qui connaissent les codes du quartier, qui parlent le même langage et qui ont eux-mêmes traversé des parcours de vie difficiles. Leur présence permet d’établir un premier lien, basé non pas sur l’autorité institutionnelle, mais sur la reconnaissance mutuelle.
Ces référents doivent être entourés d’éducateurs spécialisés, capables de poser un cadre solide et de transformer la proximité en véritable accompagnement éducatif. Ce sont eux qui “mouillent la chemise”, qui acceptent de travailler en immersion dans les quartiers, le soir, le week-end, dans des conditions parfois rudes. Leur rôle est de canaliser les énergies, de fixer des limites claires sans couper le dialogue, et d’accompagner les jeunes pas à pas vers
d’autres perspectives.
À ce binôme s’ajoute la présence discrète mais indispensable d’un psychologue. Non pas seulement pour “analyser” ou rédiger des rapports, mais pour observer les dynamiques de groupe, repérer les souffrances invisibles, et intervenir lorsque les blessures intérieures risquent de se transformer en actes destructeurs. Le psychologue agit également en soutien des éducateurs, leur offrant des clés de compréhension et un appui face à des situations émotionnellement lourdes.
Mais pour donner du poids et de l’avenir à ces initiatives, il faut aussi impliquer des professionnels qualifiés dans les ateliers techniques proposés. Quand un groupe de jeunes participe à la rénovation d’un bâtiment, à la construction d’un lieu de vie ou à la mise en place d’un jardin collectif, ils doivent être encadrés par des techniciens reconnus dans leur domaine. Cela permet d’apprendre en pratiquant, de découvrir des métiers, et surtout de voir un résultat tangible de leur engagement.
Ainsi, un local abandonné peut être transformé avec eux, pierre après pierre, peinture après peinture, en un lieu qui devient leur espace. Ce processus n’est pas seulement formateur : il est symbolique. Les jeunes ne sont plus des occupants tolérés mais des bâtisseurs légitimes. Ce qu’ils créent de leurs mains, ils le respectent davantage et s’y sentent chez eux.
En combinant grands frères crédibles, éducateurs spécialisés engagés, psychologue attentif et professionnels de terrain, ces espaces deviennent à la fois des lieux de reconnaissance, d’apprentissage et de transformation durable.
Principes clés pour que ça marche
- Proximité : aller dans les quartiers, pas attendre qu’ils
- Crédibilité : recruter des animateurs issus du même milieu, des “anciens” respectés et accompagnés d’éducateurs spécialisés prêts à mouiller la chemise et d’un psychologue qui va observer mais aussi agir ainsi que de professionnels pour les ateliers
- Attractivité : offrir du concret (wifi, musique, petites ou grandes rétributions).
- Valorisation : donner une scène, un public, une
- Progressivité : d’abord attirer → ensuite accompagner → enfin insérer.
Ces espaces ne sont pas de simples salles d’activité : ce sont des passerelles entre la rue et la société, des lieux où l’on attire d’abord par l’accueil, où l’on accroche ensuite par l’action, et où l’on construit enfin des perspectives.
Là où l’école blesse et où la rue enferme, ces espaces doivent reconnaître, valoriser et libérer. C’est dans cette reconnaissance alternative que pourra naître une autre voie pour notre jeunesse : non plus « mordre ou mourir », mais apprendre, créer, exister et bâtir.
Laïla CASSUBIE