
Martinique. Polémique “Le Bienvenu chez toi” de S. Letchimy
Fort de France. 28 mars 2025. CCN. Depuis le passage en Martinique de Manuel Valls, la polémique fait rage. D’un côté des parlementaires tels que Marcellin Nadeau et Jean Philippe Nilor, ont même “salué l’esprit d’ouverture et de dialogue de Valls” De son côté le PPM a quelque peu rétropédalé en demandant au ministre de “prendre ses responsabilités” sur la question des financements des allocations individuelles.
L’analyse de Jeff Lafontaine correspondant CCN en Martinique et observateur attentif de la vie politique de son pays
Partagez sur
Partagez sur
Le devoir d’un intellectuel est de ne jamais se taire. » — Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme (1950)
Alors que l’exclusion de la jeunesse martiniquaise atteint des sommets, nos gouvernants, dans une forme d’aveuglement obstiné, persistent à chercher les solutions dans les mêmes recettes éculées. L’analyse rigoureuse des données récentes, des dispositifs en place et des dynamiques à l’œuvre sur notre territoire dresse un constat implacable : les politiques publiques destinées aux jeunes martiniquais sont, depuis des décennies, inefficaces, déconnectées, et plus souvent conçues pour rassurer les bailleurs que pour répondre aux besoins réels de notre jeunesse.
La jeunesse reléguée, symptôme d’un échec global
Ce drame s’incarne dans un chiffre glaçant : près de 26 % des jeunes de 15 à 29 ans en Martinique sont classés NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation), soit près du double de la France. Seuls 27 à 32 % des jeunes occupent un emploi, contre près de 50 % en France. Le taux de chômage des moins de 30 ans atteint 24 %, et un jeune sur quatre sort du système scolaire sans aucun diplôme. À cela s’ajoute une inadéquation criante entre l’offre de formation et la réalité du marché local : 18 % des demandeurs d’emploi n’ont pas atteint le niveau CAP-BEP, mais seulement 3 % des offres leur sont destinées.
Face à une telle désolation, après avoir déployé le RAID, le GIGN, les CRS, voilà que nos gouvernants réclament désormais des radars, des avions, des hélicoptères pour lutter contre le trafic de drogue et d’armes. Certes, le danger ne doit pas être sous-estimé, mais il faut souligner que l’implication d’une partie de notre jeunesse dans ces circuits est souvent le symptôme, et non la cause, d’une détresse sociale profonde. Plutôt que de s’attaquer aux racines du mal – qu’elles soient éducatives, économiques ou sociales – on privilégie la réponse répressive, spectacle sécuritaire en guise de politique publique.
Dans ce climat, on alimente les fantasmes de certains activistes assimilationnistes qui, oubliant toute perspective d’émancipation, rêvent d’une égalité factice, réduite à un accès indifférencié à la consommation. Ce mirage républicain, fondé non sur la justice mais sur le contrôle, ne fait qu’approfondir les fractures et masquer le désengagement de l’État comme les responsables des institutions martiniquaises.
Et cela fait jubiler certains, satisfaits de voir la Martinique réduite à un théâtre d’ombres où l’ordre colonial tient lieu de projet républicain.
Et pourtant, certains de nos élus de la CTM continuent de réclamer, à chaque occasion, plus de compétences, plus de moyens, plus de pouvoirs. Ils militent pour une « différenciation », pour une « liberté locale de faire », tout en étant incapables d’assumer les compétences déjà dévolues dans le cadre de l’article 73 de la Constitution. La formation professionnelle, la gestion des fonds européens, le pilotage des politiques d’emploi, les réponses à la jeunesse… tout cela leur appartient déjà en grande partie. Or, que font-ils de ce pouvoir ?
Rien de structurel.
Rien de transformant.
Rien de libérateur.
Ils s’enferment dans un jeu de dupes, réclamant d’une main ce qu’ils renoncent à exercer de l’autre. Et face à cette impuissance persistante, le vieux réflexe du colonisé ressurgit : celui qui consiste à attendre du « maître des lieux », en visite expresse, qu’il comprenne et résolve, en quelques poignées de main et mots en créole, ce que nos gouvernants locaux cherchent vainement à résoudre depuis plus de 85 ans. Ce mécanisme bien rodé prépare le terrain à ces mises en scène rituelles où la domination s’exprime sous couvert de proximité.
Symboles républicains, réflexes coloniaux
Ces visites officielles, formatées depuis des décennies, ne visent qu’à ancrer dans les imaginaires que la Martinique est un « sac de problèmes » à résoudre.
Le protocole est immuable : on descend d’un avion, on effectue au pas de charge le tour de quelques institutions, on serre quelques mains sur les marchés, on distribue des tapes dans le dos, on baragouine quelques mots en créole, saw fè, sa ka maché — et l’on repart, satisfait d’avoir coché la case de la proximité.
Faut-il rappeler que c’est ce même Manuel Valls qui, alors maire d’Évry en 2009, s’est illustré par une remarque révélatrice de ses représentations raciales ? Lors d’un reportage diffusé sur Direct 8, arpentant une brocante dans sa ville, il lâche avec un soupir : « Belle image de la ville d’Évry… » avant de demander à son collaborateur : « Tu me mets quelques Blancs, quelques white, quelques blancos. » Une scène brève mais éloquente, symptomatique d’un imaginaire empreint de mépris social et racial. On imagine sans peine le malaise de celles et ceux, trop souvent assignés au rôle de figurants souriants, relégués à une exotisation condescendante.
C’est encore lui qui a été condamné en Espagne à verser 277 000 euros pour financement illégal de sa campagne municipale à Barcelone en 2019. Une campagne qui s’est soldée par un cuisant échec : une quatrième place et à peine 13,2 % des suffrages. Preuve, s’il en fallait encore, que la posture d’autorité et les ambitions personnelles ne sauraient masquer longtemps l’indigence politique.
Cette mise en scène paternaliste, teintée de mépris et d’ignorance, sert d’empreinte de domination : une démonstration d’autorité coloniale sous couvert de républicanisme affable. Et nos élus locaux, loin de s’y opposer, y participent avec docilité. Ils courbent l’échine, posent pour la photo, remercient pour 10 millions d’euros – une aumône à l’échelle des enjeux – et se livrent à une mise en scène d’allégeance émue. « Bienvenu chez toi », dira même le Président de la Collectivité Territoriale au Ministre Manuel Valls, alors que celui-ci est rejeté dans de larges territoires de France pour ses positions droitières.
Autonomie proclamée, dépendance assumée
Cet accueil flagorneur est une insulte à l’intelligence politique et au courage historique que la situation exige.
Cette scène, d’une absurdité coloniale presque caricaturale, révèle l’incapacité chronique de nos responsables à sortir du cadre de la supplique, à s’affranchir de cette posture de mendicité institutionnelle qui bride toute vision de souveraineté et de responsabilité. Pire, ils réclament plus de pouvoir tout en refusant obstinément d’envisager une véritable sortie du cadre républicain colonial français dont ils vantent la sécurité. C’est-à-dire qu’ils veulent plus de responsabilité, sans jamais en assumer les conséquences politiques. À force de tergiversations, ils rendent toute transformation impossible.
Dans ce même registre de duplicité politique, on a récemment annoncé l’intention de déposer plainte contre l’État français, arguant que ce dernier serait redevable d’une somme de 1,5 milliard d’euros à la CTM. Une démarche aussi tonitruante que stratégique, mais à laquelle le ministre a répliqué avec sévérité : l’État n’est pas responsable de la mauvaise gestion des finances publiques locales. Et les faits sont là : bourses étudiantes versées avec des mois de retard, service public de transport inefficace et désorganisé, gestion de l’eau laissée à l’abandon avec des réseaux défaillants et une autorité unique de l’eau (CTM-SME) incapable d’agir avec efficacité. De nombreux organismes satellites sont aujourd’hui asphyxiés financièrement, ou encore des missions locales peinent à remplir leurs missions faute de financements réguliers.
Quant à l’organisation administrative de la CTM, elle se caractérise par une instabilité chronique, sans vision directrice ni stratégie cohérente, ce qui alimente le malaise profond de l’institution et le désarroi croissant de ses agents.
Pendant ce temps, les martiniquais trinquent, de plus en plus de jeunes errent et les promesses ministérielles, vides de toute ambition politique, servent d’écran à l’absence totale de projet à la hauteur des enjeux.
Le verbe de Césaire, l’oubli des héritiers
Avec de tels résultats, nous sommes à mille lieues d’une politique se réclamant de la gauche, et encore plus d’un leadership fidèle à la pensée d’Aimé Césaire, pensée tournée vers la dignité, l’émancipation et l’unité des peuples opprimés. Une partie de la classe politique actuelle se contente de jouir du pouvoir sans jamais en assumer les responsabilités historiques. Elle détourne les leviers institutionnels pour les mettre au service de sa propre conservation, au lieu d’en faire des instruments de transformation sociale. Enfermée dans une logique gestionnaire, elle reste sourde aux urgences sociales, culturelles et identitaires qui fracturent notre société.
Cette élite a déserté le combat pour l’émancipation et la fraternité caribéenne. Elle parade, bruyamment, en récupérant le fruit du travail des militants de terrain, pour occuper des strapontins régionaux où elle n’a ni voix ni poids. Là, elle assiste, muette, au développement de nations caribéennes souveraines, actrices de leur destinée, pendant que la Martinique reste engluée dans les dépendances héritées de la colonisation.
Le drapeau, la musique, la langue créole – jadis symboles de lutte et de dignité – sont désormais vidés de leur sens, réduits à de simples oriflammes folkloriques. Des marqueurs d’appartenance utilisés non pour affirmer une souveraineté culturelle, mais pour masquer une allégeance résignée à la domination que ces mêmes symboles contestaient hier.
De la lucidité à l’action : pour un nouveau cap politique
Ce texte, intitulé « Bienvenu chez toi », est à la fois un cri d’alerte et un appel à la lucidité collective. Il nous faut reconnaître que la Martinique ne sortira pas de cette impasse en continuant d’appliquer des recettes usées, dictées par une administration éloignée des réalités locales, et en ignorant les potentiels immenses de sa jeunesse. Nous devons impérativement décoloniser notre regard, cesser de tendre la main pour des miettes, et rompre avec cette culture de dépendance.
Il est temps de reconstruire un lien de confiance avec une classe politique réellement engagée, de porter une politique publique de réarmement social et économique, jusqu’à rendre insupportable l’absurdité du système actuel et ouvrir la voie vers la pleine souveraineté. S’il est légitime de devoir parer à l’urgence du quotidien parfois difficile, cela ne saurait nous absoudre de garder le cap vers l’objectif fondamental : la libération politique, sociale et culturelle de notre peuple.
Cela suppose d’abord un aveu clair de l’échec des politiques d’intégration menées jusqu’ici. Il faut replacer l’éducation au cœur du projet collectif, refonder en profondeur l’appareil de formation professionnelle, articuler avec lucidité les besoins du territoire aux ressources humaines locales, et surtout rompre avec les logiques de clientélisme, d’entre-soi et de déresponsabilisation qui gangrènent les institutions et bloquent toute dynamique de transformation.
La jeunesse martiniquaise n’a pas besoin de pitié, encore moins de condescendance. Elle réclame du respect, de la considération, et surtout des opportunités concrètes, construites ici, par nous et pour nous. Tout le reste n’est que poudre aux yeux.
Alors oui, « Bienvenu chez toi »
Bienvenu dans cette maison que tes prédécesseurs, depuis des décennies, et toi-même aujourd’hui, avez méthodiquement défigurée, dont vous avez trahi les fondations et que vous avez transformée en ruine. Car c’est bien vous – toi et tes comparses – par vos renoncements, vos calculs, vos refus obstinés de voir et d’agir, qui avez bâti ce champ de désolation.
Et tu ne l’as pas fait seul : une part non négligeable de mes anciens compagnons politiques t’a soutenu, accompagné, légitimé – par opportunisme, par inertie ou par lâcheté. Ce décor n’est pas le fruit du hasard : il est ton œuvre, et celle de tous ceux qui ont préféré le confort du silence à l’exigence du courage.
Jeff Lafontaine ( CCN)
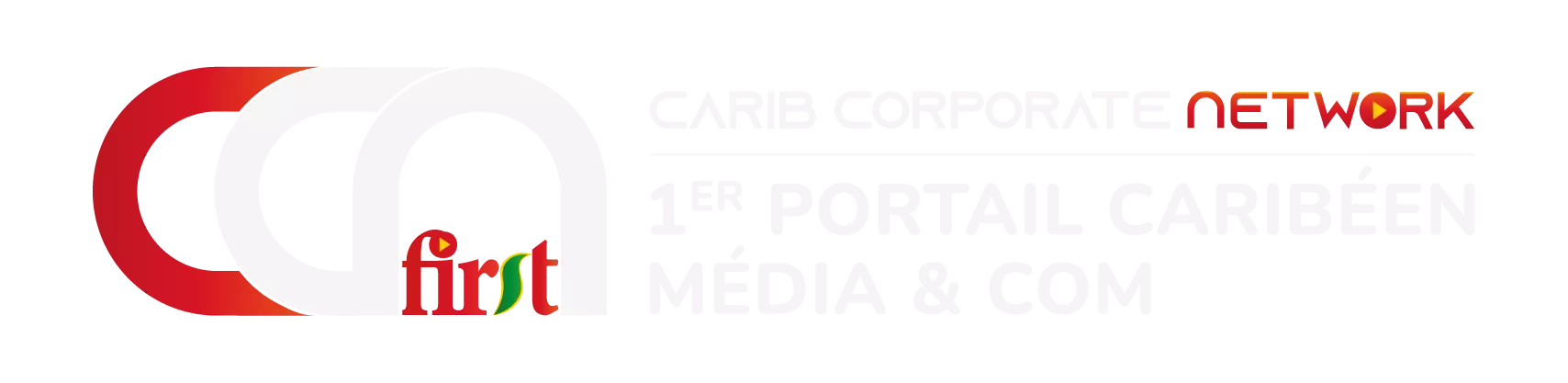














Tout est dit et bien dit
La classe politique martiniquaise comme la classe politique guadeloupéenne moins la guyanaise est incapable de se penser par et pour elles mêmes , victime d un indépassable de l ´Affranchi qui libéré des chaînes de l Habitation esclavagiste est infoutu de la quitter pour aller bâtir un chez soi ailleurs et redemande au Maître de lui donner des chaînes un peu plus légères … de réduire le nombre de coup de fouet … pour éviter la responsabilité d être responsable…
Qd tout ceci se double d un syndrome de Stockholm … il faut appeler Françoise Dolto plus Lacan plus Fanon … Nou mal enkayé …
GB 🥷🏴☠️🇸🇷🇸🇷🇺🇸🇨🇳🇮🇩🇨🇬